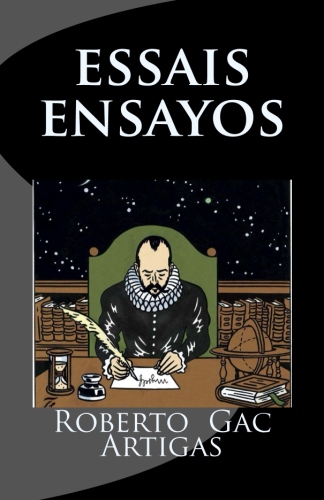Un adolescent choisit d’écrire pour échapper à une oppression dont il souffre et à une solidarité qui lui fait honte […] Il se découvre, dès qu’il prend la plume, comme conscience sans date et sans lieu, bref comme l’homme universel.
Jean-Paul Sartre « Qu’est-ce que la littérature ? »
(La Nausée)
C’est à Santiago du Chili, en 1959, à l’âge de 17ans, étudiant en 2ème année de médecine, pensionnaire à la résidence universitaire de l’Opus Dei, que je découvris l’œuvre de Jean-Paul Sartre en lisant son roman La Nausée. J’apporte ces précisions sur ma situation – étudiant encore adolescent, petit-bourgeois et provincial, en contact quotidien avec la mort dans les pavillons d’anatomie, résidant dans une pension à la fois luxueuse et sombre où nos sorties, nos lectures et même nos idées étaient étroitement surveillées - car il me semble que cela explique, en grande partie, mon admiration pour un penseur qui non seulement décrivait l’angoisse où je demeurais, mais qui parlait aussi de la possibilité offerte à l’homme de « choisir », d’exercer une liberté pour moi seulement rêvée et, par-là, d’atteindre à une véritable authenticité de l’être.
Sartre était célèbre grâce à ses romans et ses pièces de théâtre. La presse le reconnaissait comme le père de l’existentialisme, tout en l’associant aux mondanités du quartier parisien de Saint - Germain-des-Prés. Ses Carnets de la drôle de guerre (Sartre 1995), rédigés alors qu’il était mobilisé en Alsace pendant la « drôle de guerre », peu avant l’invasion de la France par la Wehrmacht, ne furent publiés qu’après sa mort à Paris, en 1980. Pour la rédaction des quinze Carnets (dont une bonne partie disparut pendant son emprisonnement en Allemagne), Sartre avait pris comme référence le Journal d’André Gide, qui concernait la première guerre mondiale :
Peu à peu le commerce avec un esprit de “ma partie” me redonne une sorte de légèreté intellectuelle que j’ai perdue tout net depuis le 1er septembre. Et puis toujours ce truquage rassurant : en identifiant ma guerre avec la sienne, comme plus d’un épisode ou d’une réflexion m’y incitent, je fais de cet avenir incertain et inconnu, informe, une chose déjà vécue et qui a un après (…),
confie-t-il dans son Carnet I (Sartre 1995, 34)1, le 18 septembre 1939, ouvrant à son insu la voie à un nouveau type de rapport lecteur/écrivain et à ce qu’aujourd’hui nous pouvons appeler « le dialogue intertextuel », cadre que j’ai choisi pour cet essai (Gac 2012b , 2016).
Stimulé par la lecture de ses romans, je réussis à faire quelques choix d’importance : je quittai la résidence de l’Opus Dei, où la lecture de La Nausée m’avait été honteusement interdite2, et je pris la décision de devenir, à l’instar de celui que je considérais désormais comme mon maître existentiel, un romancier. La littérature s’offrait à ma conscience comme la voie du salut, l’issue pour développer une vie libre et harmonieuse. Cependant, je serais peu à peu déçu d’une liberté plutôt livresque, d’ordre conceptuel, sans lien concret avec ma vie de tous les jours. Car il me fallait continuer à vivre, ce qui dans ma situation spécifique signifiait la poursuite, conseillée et programmée par mon entourage, de mes études de médecine. Mes projets d’écriture - nouvelles, essais, poèmes, ébauches d’un roman - échouaient un par un et je me retrouvai accablé par l’angoisse. La peur de devenir fou me saisit, cette peur dont Sartre parle dans le Carnet XIV (Sartre 1995, 575), le lundi 11 mars 1940 :
Je n’ai pressenti l’irréparable qu’à une ou deux reprises, par exemple lorsque j’ai cru devenir fou. À ce moment-là j’ai découvert que tout pouvait m’arriver à moi. C’est un sentiment précieux et tout à fait nécessaire à l’authenticité, et que je m’efforce de conserver autant que je peux.
Ce sentiment, aussi précieux qu’effroyable, me poussa à entreprendre une psychanalyse qui allait durer plusieurs années. Obligé par les circonstances à me soumettre aux contraintes de la vie universitaire, horizon social immédiat de mon existence, je constatai de surcroît que je n’avais aucun contrôle efficace sur ma vie psychique : l’angoisse me guettait et m’envahissait sans que je puisse rien faire. Pris en tenaille par ce double processus d’encerclement : l’un social (mon milieu universitaire), l’autre individuel, psychologique (je souffrais, d’après mon psychanalyste, d’une « névrose d’angoisse » due à des « conflits inconscients »), je n’avais pas d’autre atout que ma conscience d’être prisonnier. C’était ça ma liberté !
En effet, la rigueur académique de la faculté de médecine ainsi que la violente contradiction sociale établie entre nos malades - presque tous issus des couches les plus défavorisées de Santiago - et nous-mêmes, étudiants d’origine aisée, m’oppressaient lourdement. D’autre part, la psychanalyse, après m’avoir permis de transformer mon angoisse abstraite, globale, en une sorte d’anxiété morcelée, plus concrète et supportable, me faisait entrer dans le cercle vicieux du déterminisme psychologique : mes sentiments et mes idées étaient constamment déterminés non par moi-même, mais par l’Inconscient, territoire inabordable et fugitif comme un mirage dans le désert infini de la psyché. Dans ces conditions de double oppression, sociale et psychique, toute création m’était impossible. J’essayai, comme ultime rempart contre un effondrement de ma personnalité, d’approfondir mes connaissances en m’inscrivant, parallèlement à la faculté de médecine, à la faculté de philosophie. Je n’avais plus une confiance inconditionnelle dans les théories de Sartre (dont le concept de liberté me permettait, dans le meilleur des cas, de m’asseoir à la terrasse d’un café et de me dire, au moment d’allumer une cigarette et d’entamer une bière fraîche : « je suis libre ») et je me tournai vers Hegel pour étudier la Phénoménologie de l’Esprit.
L’étude de la dialectique du Maître et de l’Esclave, décrite dans le quatrième chapitre de la Phénoménologie, me mit rapidement sur la voie d’une compréhension nouvelle du concept de « liberté ». Car si Sartre affichait son « désir d’être libre, c’est–à-dire de dominer les événements » (Carnet I, 14 septembre 1939), cette liberté n’était autre que “la liberté des maîtres”. Maintenant, grâce à Hegel, je voyais bien que l’homme en situation d’esclavage, de soumission, ne peut échapper à sa condition qu’à travers son travail, son œuvre, pour s’y reconnaître, passant ainsi de la situation de conscience de soi malheureuse à une autre où la conscience de soi est en soi et pour soi, c’est-à-dire, une situation où la conscience est devenue « autoconscience » (Selbstwebusstsein)3. Il fallait vivre, « travailler », faire « œuvre », seule issue pour sortir du malheur de l’angoisse et devenir autoconscient, libre et authentique. D’ailleurs, Sartre lui-même, analysant le concept d’authenticité (Carnet III lundi 27 novembre 1939) le définit dans ce sens, celui de « l’apprentissage de la situation », donc de l’effort :
L’authenticité n’est pas exactement cette ferveur subjective. Elle ne peut se comprendre qu’à partir de la condition humaine, cette condition d’un être jeté en situation. L’authenticité est un devoir qui nous vient à la fois du dehors et du dedans parce que notre “dedans” est un “dehors”. Être authentique, c’est réaliser pleinement son être-en-situation, quelle que soit par ailleurs cette situation, avec cette conscience profonde que par la réalisation authentique de l’être-en-situation on porte à l’existence plénière la situation d’une part et la réalité-humaine d’autre part. Cela suppose un apprentissage patient de ce que la situation exige et puis, ensuite, une façon de s’y jeter et de se déterminer soi-même à “être-pour” dans cette situation. (Sartre 1995, 244)
Pour moi, travailler, faire « œuvre », former (formieren dans la terminologie hégélienne), ne pouvait être autre chose qu’écrire, faire « œuvre littéraire », parce que la pratique de la médecine, aussi bien que celle de la philosophie, échappait à mon désir d’écriture, à ce que j’appelais obscurément ma « vocation artistique », concept qui cachait mon désir de liberté absolue. Car étant médecin, attaché à une consultation, ou bien professeur de philosophie, j’étais toujours dépendant, au service d’une institution telle que l’hôpital ou l’université. À travers ces institutions j’étais le « serviteur » des autres - malades, étudiants - mais eux n’étaient que des « maîtres particuliers », lesquels ne pouvaient pas me rendre ma liberté absolue. Par conséquent, pour atteindre à cette liberté, je ne pouvais reconnaître d’autre maître que le « Maître Absolu » dont parle Hegel et n’accomplir d’autre service que celui du « monde-en-général ». Et le chemin de ce service, qui ne reconnaissait aucun maître particulier, était celui de l’écriture détachée de tout compromis, de toute soumission, soit à un homme, soit à une institution. Ce fut pour ces raisons, pour accéder à la liberté absolue, que je choisis d’être un écrivain entièrement dévoué à une seule tâche : celle d’écrire. Dans ses Carnets, Sartre ironise quelque peu sur sa propre décision de se consacrer exclusivement à écrire :
Je pense rester fidèle à la vérité en distinguant trois périodes (…) dans ma vie de jeune homme et d’homme. La première va de 1921 à 1929, c’est une période d’optimisme, le temps où j’étais “mille Socrate”. À ce moment-là je pense de gaieté de cœur qu’une vie est toujours ratée et je construis une morale métaphysique de l’œuvre d’art. Mais, au fond, je ne suis pas du tout convaincu ; le vrai c’est que je suis persuadé qu’il suffit de se consacrer à écrire et que la vie se fera toute seule pendant ce temps-là. Et la vie qui doit se faire, elle est déjà prétracée dans ma tête : c’est la vie d’un grand écrivain, telle qu’elle paraît à travers les livres. Il y a cette confiance magique, au fond : pour avoir la vie d’un grand écrivain il suffit seulement d’être un grand écrivain. Mais pour être un grand écrivain il n’est qu’un moyen : s’occuper exclusivement d’écrire. (Sartre 1995, 268, Carnet III, vendredi 1er décembre 1939).
Et quelques paragraphes plus loin (Sartre 1995, 271), il ajoute, à propos de la liberté hégélienne :
J’avais toujours pensé qu’un grand homme devait se garder libre. Il ne s’agissait pas là de la liberté bergsonienne du cœur ni surtout de celle que j’ai découverte à présent en moi et qui n’est pas une plaisanterie, mais d’une sorte de caricature de la liberté hégélienne : se garder libre pour réaliser en soi et pour soi l’idée concrète du grand homme.
Certes, en dépeignant aussi ironiquement ses ambitions de jeunesse, Sartre se moque de lui-même. Et pourtant, comme dans toute caricature réussie, il y a quelque chose de profondément vrai dans ce qu’il dit. Peut-être lui aurait-il suffi de gommer l’adjectif « grand », de « grand homme» « grand écrivain », etc., pour y reconnaître la liberté telle que Hegel la conçoit. Mais Sartre, comme j’allais le découvrir plus tard dans L’Être et le Néant, n’aime pas beaucoup Hegel. Il parle de « l’échec de Hegel » et, par une cabriole magique qu’il appelle « dialectique intemporelle », il place sa pensée théoriquement après Husserl. Hegel (1770-1831) serait donc en progression théorique par rapport à Husserl (1859-1938) et, par conséquent, on est bien obligé de considérer que Husserl serait en régression par rapport à Hegel ! Passons. Puis, lorsqu’il fait la critique, trop rapide, de la dialectique du Maître et de l’Esclave, il n’analyse pas la « peur » (Furcht) de l’esclave face au maître et il ne s’attarde pas non plus sur l’importance de son « travail » (Bearbeitet), seule voie pour obtenir sa reconnaissance comme conscience de soi et atteindre l’autoconscience en se libérant du maître, qui tombe dans le « désespoir » (Verzweiflung). Nonobstant, sa « longue critique » (une petite dizaine de pages) lui permet de donner une perspective matérialiste à la phénoménologie hégélienne de la conscience : il pose l’existence de la conscience avant sa connaissance. C’est le génie de Sartre.
Donc, ce fut grâce à la Phénoménologie de l’Esprit que je pus préciser les concepts de « travail » et « d’œuvrer » (formieren) dans le sens de « culture » (Bildung). Le travail se montre comme fait décisif pour atteindre l’autoconscience et, par là, la liberté. Désormais, il me fallait mettre toutes ces idées en pratique, je devais me consacrer à écrire, à former mon œuvre littéraire. Pour cela, je dus pratiquement tout abandonner, au moins au sens matériel du mot. La pratique médicale et ma carrière universitaire, pour brillantes qu’elles s’offrissent à mes yeux, n’étaient nullement compatibles avec mon rêve d’écriture totale. Je me résignai donc à quitter ma situation de « el Señor Doctor» et à renoncer à tous les avantages économiques qu’elle impliquait. Je fus même contraint, pour accompagner mon geste de totale renonciation à la vie « ordinaire », de quitter ma famille, de m’exiler hors des frontières du Chili, d’abord aux États-Unis (où j’exercerais brièvement au Columbus Hospital à New York), puis en Europe. Il était évident pour moi qu’aucune authenticité ne me serait permise, aucune catharsis scripturale et spirituelle n’aurait lieu dans mon existence, si je ne me plaçais pas d’abord en situation d’être-libre-pour-mon-destin : celui d’écrire, d’être purement et simplement un écrivain… et rien d’autre. Tout au plus, comme seule attache à ma vie ancienne, je vécus quelque temps de mes économies accumulées pendant ma courte carrière de psychiatre, argent qui me permettrait de vivre très modestement, en pleine solitude, dans un village de pêcheurs, au bord de la Méditerranée. Il y avait là, sans doute, une sorte de tentative de « salut par l’art », de morale esthétique, telle qu’elle fut reconnue et vécue par Sartre à un moment de sa jeunesse. Pourtant cette similitude n’est qu’apparence. Effectivement Sartre, parlant de la période 1931-1933, lorsqu’il était encore professeur dans un lycée du Havre, écrivit ceci :
Désormais, pour moi, l’écrivain se jugeait à ses œuvres -objectivement- et sa vie ne différait pas des vies les plus médiocres. Racine était un petit-bourgeois du temps de Louis XIV. Mais ce petit-bourgeois avait écrit “Phèdre”. On ne pouvait pas remonter des œuvres à la vie, elles s’échappaient de la vie, roulaient hors d’elle et restaient dehors, pour toujours (…) À partir de là, je m’attachais avec une espèce d’acharnement à écrire. Le seul but d’une existence absurde, c’était de produire indéfiniment des œuvres d’art qui lui échappaient aussitôt : c’était sa seule justification ; une justification imparfaite d’ailleurs, qui n’arrivait pas à sauver ces longs glaires de temps qu’il fallait avaler un à un. C’était vraiment une morale du salut par l’art. Pour la vie elle-même, il fallait la vivre à la va-comme-je-te-pousse, n’importe comment… (Sartre 1995, 274, Carnet III, vendredi 1er décembre, 1939).
On voit bien ce que Sartre voulait dire par l’expression « salut par l’art ». Pour lui, le fait d’écrire n’était qu’une justification possible d’une vie de toute façon médiocre, absurde, l’œuvre littéraire restant séparée de la vie elle-même et sans aucune incidence sur elle. Pour lui le rapport Œuvre/Vie n’était qu’une antinomie conceptuelle, sans lien nécessaire entre les deux termes. Dans ce même Carnet (Sartre 1995, 286), le samedi 2 décembre 1939, il reviendra encore sur le problème :
…Officiellement tout n’était que contingence et toute vie était perdue, il n’était possible que de créer hors de soi des œuvres belles. Mais par en dessous, j’étais bien persuadé que j’aurais une vie qui répondrait à mes œuvres et je recherchais l’amitié, l’amour, toutes les passions, je quêtais toutes les expériences. Et pour mériter cette vie que j’attendais - mais par rapport à laquelle je n’étais pas encore engagé, je me considérais comme encore libre - je ne jugeais pas suffisant d’écrire, il fallait encore que je fusse moral. Cette morale, c’était pour moi une transformation totale de mon existence et un absolu.
Et encore, au paragraphe suivant (Sartre 1995, 286), quelque peu contradictoire, il insiste :
Alors la morale esthétique que je m’étais donnée par un pessimisme de générosité, prit peu à peu plus d’importance à mes yeux. Il n’était pas bon que l’homme se connût, s’occupât trop de lui-même, il ne fallait qu’écrire et créer. Pourtant je ne renonçais pas à l’absolu mais, par un glissement fort naturel, il s’en vint revêtir les œuvres de l’homme. Désormais l’homme était une créature absurde, dépourvue de raison d’être, et la grande question qui se posait, c’était celle de sa justification. Je me sentais moi-même tout falot et injustifié. Cette justification, seule l’œuvre d’art pouvait la lui donner, car l’œuvre d’art est un absolu métaphysique. Ainsi voilà l’absolu rétabli mais hors de l’homme. L’homme ne vaut rien.
C’est clair : Sartre ne reconnaît pas un lien dialectique - vivant, dynamique - entre la vie et l’œuvre de l’écrivain. Pour moi (son lointain disciple) les choses se présentèrent d’une façon différente. Se consacrer exclusivement à écrire signifiait, dans ma situation concrète, être pour et par l’écriture, vivre pour écrire, mais aussi écrire pour vivre, non dans le sens pécuniaire, purement contingent du terme (pauvreté ou richesse, cela m’était égal), mais, avant tout, comme moyen d’acquérir la liberté absolue. L’écriture, l’œuvre littéraire n’étaient pas pour moi la justification gratuite d’une vie perdue d’avance, mais l’instrument, le moyen de développement de cette vie pour la réussir. Inversement, la vie, avec toutes ses contingences, ne pouvait prendre sa véritable saveur, sa valeur réelle, que dans la mesure où elle était entièrement orientée, dévouée à l’accomplissement de cette œuvre dans un mouvement dialectique sans faille et sans fin. Dans ces conditions, la morale esthétique qui découlait de ce processus était pour moi bien simple : tout ce qui était bon pour l’accomplissement de mon œuvre était nécessairement bon pour ma vie… et vice-versa. Si l’œuvre d’art ne pouvait plus prétendre au statut d’absolu métaphysique, puisqu’elle n’était pour moi que le moyen d’une vie accomplie - la mienne - son élaboration me permettrait au moins d’avoir, en tant qu’homme, une valeur relative : celle de mon œuvre littéraire.
(La Curación / La Guérison)
Mis alors en situation « d’être-exclusivement-pour-écrire », préparé socialement et psychiquement pour le faire, je commençai, après avoir quitté la pratique médicale, à écrire sans cesse, à la recherche d’un accomplissement textuel le plus parfait possible. Hélas, je compris vite que la clarté existentielle et l’authenticité n’étaient pas suffisantes pour mener à bien une entreprise de création. Car, si j’avais accumulé des connaissances dans les domaines de la médecine, de la philosophie et de la psychologie, je ne savais toujours pas comment écrire un roman. Pire, le genre « roman » se révéla inadapté à mon projet dans la mesure où la fiction me semblait « inauthentique » par définition. Et même si, poussé par un fort élan de liberté scripturale, j’avais rédigé en peu de temps un manuscrit considérable, développé sous le titre de La Curación (La Guérison), je ne savais toujours pas quelle forme arrêter pour cette masse textuelle mouvante où je racontais l’histoire d’un psychotique, sorte d’incarnation de la « conscience malheureuse » à la recherche, précisément, de sa guérison, de son autoconscience. C’était le roman en tant que genre, en tant que forme littéraire, qui se dressait devant moi à la fois comme une énigme et comme un mythe, provoquant dans ma pensée maintes contradictions. Pendant mon adolescence, j’identifiais volontiers le roman et la littérature en un seul corps, la poésie, le théâtre et l’essai n’étant pour moi que des formes secondaires4. Et je regrettais que Sartre eût abandonné l’écriture romanesque après la publication de sa trilogie Les Chemins de la Liberté. Je craignais que derrière ses activités journalistiques, sociales et politiques ne se cache une sorte de dilettantisme, de manque de sérieux. En revanche, Proust et Joyce, ses contemporains immédiats, dont les œuvres faisaient aussi partie de mes lectures à la même période, me donnaient l’exemple du romancier fidèlement et exclusivement attelé à sa tâche littéraire. D’un autre côté, tout en étant très isolé dans le refuge que j’avais choisi à Jávea, sur la Costa Blanca espagnole, je continuais à recevoir des journaux, américains surtout, où le roman était l’objet d’un culte idolâtre et le romancier assigné au rôle de prêtre et même de divinité d’un art présenté comme « libre ». Toutefois, cette soi-disant « liberté de l’art romanesque » impliquait le détachement de tout engagement social, politique et psychologique. Le roman pouvait, à la limite, poser des questions, mais ne devait jamais donner de réponses et, encore moins, prétendre apporter des solutions aux problèmes existentiels. D’après la grande majorité des critiques américains, le « good novelist » ne devait s’intéresser ni à sa personne ni aux causes des méfaits de la société capitaliste (« no lessons »). En revanche, il lui était conseillé de raconter des histoires inventées de toutes pièces, et de prouver ainsi la génialité de son imagination « créatrice », ou bien, d’écrire des polars où la police s’occupe de résoudre les injustices sociales à coups de poings et de revolver. Voilà le « good way » pour gagner un « book prize » et devenir « best-seller ». C’était, en quelque sorte, la réplique idéologique, à peine voilée, contre la littérature « engagée » prônée par Sartre, doctrine qui supposait une remise en question de l’organisation capitaliste de notre société et une introspection profonde de l’écrivain et de ses « alter ego », les personnages romanesques.
Dans ce sens, Proust et Joyce me montraient, eux aussi, l’importance de l’exégèse de la vie de l’artiste. Engagé moi-même dans la recherche de l’authenticité, j’éprouvais la nécessité irréductible de me pencher non sur des histoires purement fictives, mais sur ce phénomène toujours obscur et indéchiffrable qu’était mon existence. Sartre, parlant de cette attitude, qui ne relève pas nécessairement du narcissisme (dont il fut souvent accusé), note dans son Carnet XII (Sartre 1995, 527), le 29 février 1940 :
Mon être-dans-le-monde c’est un-être-en-situation-irréalisable, je suis tout entier dans cet événement dont la beauté m’attire et me fuit : c’est ma vie. C’est ce qui explique ces comédies que je joue constamment sans en être profondément dupe, qui sont comme des pantomimes pour capter l’irréalisable, des danses magiques, c’est ce qui explique aussi ces retours brusques de grossièreté et de cynisme qui ont souvent dérouté et choqué des gens qui m’entourent. Bref, c’est ma passion, et ma passion c’est moi.
Peut-on parler de « narcissisme » en littérature lorsque l’objet de celle-ci est l’écrivain lui-même, qui écrit non pour se regarder et se satisfaire du reflet de son propre égo, mais pour se connaître et s’étudier à l’instar d’un insecte observé par un entomologiste ? « Me traiter - non par intérêt pour moi, mais parce que je suis mon objet immédiat », précise Sartre le 2 octobre 1939 dans son Carnet I (Sartre 1995, 75). Malheureusement pour nous, il ne se traita jamais lui-même en tant que romancier, comme il ne fit jamais en profondeur la critique du roman en tant que genre littéraire spécifique d’une période bien déterminée de l’histoire de la littérature. Peut-être aurait-il pu le faire au moment de rédiger L’Être et le Néant (1943), lorsqu’il aborde la problématique du « mensonge » et de la « mauvaise foi », mais, de toute évidence, il ne se trouvait pas alors en situation de théoriser là-dessus. « Parbleu, je sais bien que, dans un roman, il faut mentir pour être vrai », écrit Sartre dans son Carnet V (Sartre 1995, 375), le vendredi 22 décembre 1939, en commentant la critique d’Émile Bouvier à propos de La Nausée: « Je doute - écrit Bouvier - que M. Sartre devienne un grand romancier car il semble répugner à l’artifice; et dans l’artifice il y a “art”. Il est à craindre qu’en prenant trop au sérieux sa mission, s’apercevant que les moyens d’expression dont il dispose doivent nécessairement être truqués, il ne lâche la littérature pour la philosophie, le mysticisme ou la prédication sociale ». Sartre lui répondra indirectement dans ce même Carnet (Sartre 1995, 375): « … J’aime ces artifices, je suis menteur par goût, sinon je n’écrirais point ». Peut-être dans les Carnets de la Drôle de Guerre qui sont portés manquants, fit-il la critique du genre romanesque, mais c’est peu probable puisque dans des textes postérieurs tels que Qu’est-ce-que la littérature ? ou Les Mots ou, encore, les Situations, il ne revint pas, d’une façon exhaustive, sur le sujet. Et pourtant, j’insiste, dans L’Être et le Néant il aurait pu prendre comme exemple du « mensonge » et de la « mauvaise foi », le roman et le romancier, à la place, quelque peu discutable, des coquetteries de la femme et des sentiments de culpabilité de l’homosexuel.
Tout en voulant éviter de sombrer dans les océans sans fond de la philosophie, de la politique et du mysticisme, je ne voulais pas non plus m’échouer contre le pire des écueils : le trucage, le faux-semblant, l’artifice, bref contre ce que je considérais comme étant les moyens privilégiés de l’art inauthentique. Laissant de côté mes doutes, j’avançais à tâtons dans l’écriture de La Curación en m’appuyant sur totalité de mon vécu. Il s’agissait, je le souligne, non de trouver un reflet narcissique de mon ego (je me trouvais aussi minable que le narrateur des Carnets du sous-sol, de Dostoïevski), mais d’approfondir et de parachever l’exploration de mon existence commencée quelques années auparavant et qui m’avait conduit, d’un point de vue psychologique, d’abord jusqu’à la psychanalyse freudienne, puis à m’intéresser à l’enseignement de Georges Gurdjieff.
Dans l’une des criques solitaires de Jávea, j’avais pris l’habitude de lire, après avoir déjeuné frugalement dans un bistrot du petit port de pêche, tantôt Ulysses, tantôt la Recherche, mais aussi les Fragments d’un enseignement inconnu de Piotr Demianovich Ouspensky5, le mathématicien russe, disciple de Gurdjieff, dont j’avais entendu parler à l’Institut d’Anthropologie de la faculté de médecine de l’Universidad de Chile. Le livre d’Ouspensky m’avait donné de prime abord l’impression d’une histoire invraisemblable, aux propositions simplistes, très éloignées des textes savants que j’avais l’habitude de fréquenter. Conditionné par mon éducation philosophique et scientifique, je m’acharnais à souligner et à réfuter, crayon à la main, chacune des idées proposées. Soudain, un après-midi face aux vagues tranquilles de la Méditerranée, j’eus une véritable « illumination » en éprouvant dans tout mon être la question : pourquoi t’opposes-tu à la vérité ? À partir de ce moment-là, la psychanalyse cessa de me servir de référence psychologique et scripturale. Le recours stéréotypé à Freud et à ses acolytes pour construire, interpréter et expliquer ma vie psychique (et le comportement des personnages romanesques), laissa place à une autre vision de la psyché et, par là, de la littérature.
L’écriture devenait pour moi un véritable instrument de connaissance. Elle me permettait même - à travers la mise en jeu de plusieurs personnages plus ou moins fictifs - d’observer ce qu’aurait pu être ma vie dans des circonstances jamais vécues réellement. Ce fut le cas d’au moins l’un des textes que je développais à cette époque - Portrait d’un Psychiatre - dans lequel j’essayais de me représenter d’une façon romanesque la poursuite virtuelle de ma carrière de psychiatre (le protagoniste invente une « nouvelle psychiatrie » à partir de la psychodynamique gurdjieffienne des centres psychiques multiples), cette même carrière que j’avais abandonnée dans la vie réelle. Ma méthode n’était pas très éloignée de la méthode scientifique qui se sert de modèles et d’appareils pour étudier dans l’espace clos et protégé d’un laboratoire, les lois qui régissent la nature tout entière. Si la fiction, en conséquence, était utile à mon entreprise textuelle de recherche de l’autoconscience, elle ne l’était pas en elle-même et pour elle-même, comme dans le cas du roman. En effet, dans le roman (notamment dans le roman de chevalerie de jadis et ses rejetons contemporains, c’est-à-dire, la plupart de la production romanesque d’aujourd’hui), la fiction prend abusivement la place de toute la réalité, ne comportant d’autre véracité qu’elle-même en tant que phénomène particulier. Par contre, je l’utilisai à l’intérieur d’un cadre bien défini où le registre autobiographique, la méthode scientifique et la réflexion philosophique servaient de paramètres, de points de repère capables de limiter et de conduire vers un but précis l’activité purement imaginaire de l’esprit. À cet égard, Sartre m’apporterait dans le temps une confirmation tranquillisante : « J’utilise la fiction guidée, contrôlée, mais fiction quand même », affirme-il, dans son étude sur Flaubert (Sartre 1971, 123). C’est ce qu’il fait dans La Nausée, où il expose - sous le nom de son personnage principal, Antoine Roquentin- ses propres idées et ses expériences de la période d’avant-guerre et cela, à l’égal des Carnets, en adoptant la forme d’un journal intime. Dans le Carnet XIV (Sartre 1995, 594), le jeudi 14 mars 1940, il écrit :
Pourquoi Antoine Roquentin et Mathieu, qui sont moi, sont-ils, en effet, sinistres, alors que, mon Dieu, la vie ne se présente pas si mal pour moi? Je pense que c’est parce que ce sont des homoncules. Par le fait, c’est moi, à qui l’on aurait arraché le principe vivant. La différence essentielle entre Antoine Roquentin et moi, c’est que moi j’écris l’histoire d’Antoine Roquentin (…) J’ai ôté à mes personnages ma passion maniaque d’écrire, mon orgueil, ma foi en mon destin, mon optimisme métaphysique et j’ai provoqué en eux, de ce fait, un pullulement sinistre. Eux, c’est moi décapité.
Or je n’avais aucune envie d’être décapité, même en tant que personnage. Je ne voulais pas m’arracher mon principe vivant, comme cela arrive dans La Nausée (Sartre 1959, 140) à Antoine Roquentin avec son propre personnage romanesque, le marquis de Rollebon : « Il était mon associé : il avait besoin de moi pour être et j’avais besoin de lui pour ne pas sentir mon être (…) Je ne m’apercevais plus que j’existais, je n’existais plus en moi, mais en lui. » Bien au contraire, en écrivant je voulais remplir de vie mon « principe vivant ». Mais pour cela je me devais d’accepter de ne plus être « personnage » et, par là, me résigner à abandonner la fiction romanesque et ses dérives trompeusement libertaires.
(Sartre et Heidegger, 1933-1934)
En dépit de mes tentatives, je restais dans la confusion, et cela en correspondance dialectique avec ma production textuelle, elle aussi confuse, toujours plus au moins « romanesque ». J’avais fini trois versions de La Curación, l’une d’elles sous le titre provisoire de La Sociedad de los Hombres Celestes (La Société des Hommes Célestes), mais aucune d’elles ne me satisfaisait, loin de là. J’éprouvais le vertige de l’infini scriptural et prenais conscience de l’absence de limites sûres à l’intérieur d’une pratique littéraire ouverte de tous les côtés. J’aurais pu écrire une suite ininterrompue de versions du même texte, sans trouver aucune lumière nouvelle. D’ailleurs, si les textes que j’avais déjà produits m’apportaient une certaine lueur sur ma propre existence, je ne savais pas s’ils étaient « bons » ou « mauvais » d’un point de vue littéraire, s’ils avaient de la valeur pour quelqu’un d’autre que moi. « Je ne sais pas ce que c’est bien écrire (…) On peut dire que mes phrases les mieux venues ont un aspect massif d’immeuble, avec une secrète faiblesse, un laisser-aller inavoué, qui paraît à la seconde lecture. Trop d’adjectifs, des tics que déjà on peut imiter », se plaint Sartre, sceptique sur la qualité de sa prose, le jeudi 28 septembre 1939 (Sartre 1995, Carnet I, p. 65). Pourtant, dès son enfance, Sartre fit preuve d’une étonnante assurance sur ses moyens intellectuels et sur sa propre destinée. Le doute, les hésitations n’étaient décidément pas son lot.
Parlant de sa jeunesse, de son amitié pour Nizan, de son entente avec Simone de Beauvoir et de sa tendance à « vivre public », il note, dans son Carnet XII (Sartre 1995, 511), le 28 février 1940 :
J’ai dit que mes moindres sentiments, mes moindres pensées étaient dès leur naissance publiques. Wanda s’étonnait que je puisse envisager de publier des carnets d’une sincérité totale. Mais cela m’est devenu naturel… Je sentais le regard de mes amis jusqu’au fond de moi-même, cela m’obligeait à m’éclairer au plus vite, à pourchasser la pénombre en moi et, dès qu’une pensée m’appartenait en toute transparence, du même coup elle leur appartenait aussi. Dès cette époque il régna dans mon esprit une clarté impitoyable, c’était une salle d’opération, hygiénique, sans ombres, sans recoins, sans microbes, sous une lumière froide.
Et il ajoute (Sartre 1995, 515), parlant toujours du temps où il était étudiant à l’École Normale : « Je l’ai dit, la contrepartie de cette transparence accablante était la force, la sérénité olympienne et le bonheur ». Ce n’était pas du tout mon cas et je constatais, avec désarroi, que je m’enfonçais dans le doute. Un doute qui, par ailleurs, devenait peu à peu le Doute, en correspondance avec l’incertitude dans laquelle se trouvait ma démarche scripturale. À Jávea, la lecture de Marcel Proust et de James Joyce vint encore une fois à ma rescousse et je pus constater à quel point la littérature peut être le plus merveilleux des moyens de communication entre les hommes. Toutes les théories de l’art pour l’art, de la littérature en tant que jeu purement formel du langage, tombaient devant cette expérience profonde, aussi bien intellectuelle qu’émotionnelle, que je faisais en lisant À la Recherche du Temps Perdu, Stephen Hero et A Portrait of the Artist as a Young Man. Proust, en décrivant ses angoisses et ses hésitations face à la stérilité scripturale qui le frappa pendant de longues années, et Joyce en traçant sa phénoménologie de l’artiste débutant, où le doute est dévoilé non comme stigmate mais comme le signe distinctif de l’artiste dans sa jeunesse, venaient, tous deux, calmer mon inquiétude.
Parlant de l’artiste, dans son Carnet XIV (Sartre 1995, 611), le jeudi 21 mars, Sartre affirme : « Il ne m’est jamais venu à l’idée que j’étais un artiste. Le mot, d’ailleurs, n’a pas d’importance pour moi ». Eh bien, grâce à Proust et à Joyce, je venais de confirmer que - dérouté ou non, coincé ou libéré - j’étais au moins ça : un artiste, un type d’écrivain radicalement différent de tous les autres - le journaliste, l’historien, le politicien, le philosophe, le scientifique - bref, différent de tous ceux pour qui l’écriture n’accomplit pas d’autre rôle que celui de véhiculer une information - réelle ou imaginaire - sans se soucier d’elle-même en tant que pratique formelle. Sartre n’était pas un artiste. Il fut romancier, philosophe, dramaturge, essayiste, sociologue, psychologue, mais jamais il ne fut un artiste, non seulement parce qu’il se refusait à l’être, donnant au mot « artiste » un sens péjoratif, proche du dandy noceur et élitiste, déclassé « par le haut », à la Baudelaire, mais surtout parce qu’il n’accepta jamais de vivre en tant que tel. Or, il me semble qu’un artiste authentique est celui qui - tout en s’occupant de l’expression esthétique, aisthêtikos - fait de sa propre vie la matière primordiale de cette expression, de cette forme, et cherche à établir une dialectique vivante entre ces deux termes vie/œuvre, au point d’accepter, en pleine conscience, que l’une détermine et modifie l’autre. Un artiste véritable, un aisthêtês (« celui qui sent ») possède une sensibilité particulière, il est capable d’une certaine écoute, à la fois réceptive et humble, qui lui permet - lorsque le processus de création (poêsis) dans lequel il est engagé l’impose - de se mettre au service de quelque chose - une influence, une énergie - qui, tout en le traversant et en faisant partie de lui-même à cet instant, n’est pas lui-même. Mais pour cela, pour atteindre cette forme de l’être proche de celle que les Grecs de la période présocratique reconnaissaient chez les rhapsodes (pour lesquels le problème de la liberté de la conscience ne se posait plus, tellement elle était déjà inutile au moment de la poêsis), l’artiste doit d’abord accepter de se soumettre à une force qui le dépasse. Sartre, de toute évidence, ne s’est jamais mis dans cette perspective, laquelle lui aurait imposé une sorte de soumission métaphysique.
« J’étais un infâme petit enfant-roi », écrit-il dans son journal, Carnet XII (Sartre 1995, 506), le mercredi 28 février 1940. Et, d’une certaine façon, il le fut jusqu’à la fin de sa vie, car il répugnait à se soumettre non seulement à un maître particulier, mais, surtout, il refusa toujours de se soumettre au Maître Absolu dont parle Hegel. Déjà,tout au long des Carnets, il se pose constamment en « maître », non seulement de lui-même (« Je sais que je suis parfaitement maître de moi, sans égarements, et que je peux supporter les coups durs » ; Carnet XI (Sartre 1995, 395), février 1940), mais aussi de son entourage :
Mon désir de régner se transforma seulement. Je n’avais pas perdu ce rêve de régner par l’amour sur une communauté gracieuse et oisive. Peu à peu le rêve se transforma encore (je dois dire que j’ai eu à plusieurs reprises, là encore, ce que je désirais) et devint désir d’autorité spirituelle. J’eusse voulu être le sage que l’on consulte, plus précisément un starets comme ceux de Dostoïevski. Je ne suis pas sûr qu’en me sondant bien profondément je ne retrouverais pas de parcellesde ce vieux désir… (Sartre 1995, Carnet XII, p. 522, 28 février 1940).
Quant aux écrivains et aux idéologues de son temps auxquels il se compare, sa pensée critique est, tout simplement, dévastatrice. À part l’hommage rendu à Stendhal et sa fascination à l’égard de Saint-Exupéry, la plupart des grands écrivains du 19e et du 20e siècle ne méritent de sa part que quelques commentaires amusés, méprisants ou bien insignifiants. Cela est vrai pour Proust et Joyce, pour Kafka et Jules Romains, y compris André Gide, dont le Journal lui servit pourtant de référence pour rédiger le sien. Et aussi pour Freud et Marx.
Parlant du trou en général, du trou du cul en particulier, il notera, àpropos des Freudiens :
Le trou, organe femelle et nocturne de la nature, lucarne sur le Néant, symbole des refus pudiques et violés, bouche d’ombre qui engloutit et assimile, renvoie à l’homme l’image humaine de ses propres possibilités, comme la viscosité, comme la friabilité. Il peut y avoir, il y a de la jouissance humaine à combler un trou - et qui n’est pas proprement sexuel - comme il y a une jouissance humaine à gratter une substance friable et à en détacher des fragments. Les Freudiens se sont faits les prêtres sexuels du trou mais ils n’ont pas expliqué la nature de son attrait. (Sartre 1995, Carnet V, p. 367, le jeudi 21 décembre 1939).
Et, hormis cette ultime remarque quelque peu désobligeante à l’égard desFreudiens : « Il ne faut pas prendre le point de vue de la psychanalyse, qui est encore un déterminisme et qui, comme tel - bien que se vantant d’avoir introduit l’explication par l’histoire dans la vie de l’individu - est antihistorique » (Sartre 1995, Carnet XIV, p. 548, le 7 mars 1940),c’en sera fini de Freud et de la psychanalyse.
Marx méritera à peine un meilleur sort :
Marx a posé le dogme premier du sérieux lorsqu’il a affirmé la priorité de l’objet sur le sujet. Et l’homme est sérieux quand il s’oublie, quand il fait du sujet un objet, quand il se prend pour un rayonnement qui vient du monde ; ingénieurs, médecins, physiciens, biologistes sont sérieux. (Sartre 1995, Carnet XIV, p. 578, lundi 11 mars, 1940).
Voilà Marx rangédans un placard en compagnie de quelques cadres supérieurs ! Nous ne connaissons que des fragments du journal que Sartre rédigea pendant les quelques mois où il fut soldat météorologiste et il est possible que Freud et Marx aient reçu une meilleure attention de sa part, comme ce sera le cas dans ses ouvrages postérieurs, notamment dans la Critique de la Raison Dialectique, où il accorde une importance centrale au marxisme. Par contre, il n’y a aucun doute sur le nom du seul penseur, à part peut-être Husserl, qu’il admire explicitement : Martin Heidegger. Le jeudi 1er février 1940, dans son Carnet XI (Sartre 1995, 408), Sartre écrit ceci :
En d’autres termes, c’est mon époque, ma situation et ma liberté quiont décidé de ma rencontre avec Heidegger. Il n’y a là ni hasard nidéterminisme mais convenance historique. On pourrait croire toutefoisque la question : mais pourquoi y a-t-il eu un Heidegger ? reste endehors du cycle. Et à vrai dire, en un sens elle y échappe en tant que Heidegger est l’apparition dans le monde d’une conscience libre. Mais par tout un autre côté, cependant, elle ne me paraît pas si “excentrique”. Car la philosophie de Heidegger, c’est une assomption libre de son époque. Et son époque, c’était précisément une époque tragique d’“Untergang” et de désespoir pour l’Allemagne (…) L’attitude de Heidegger est évidemment un dépassement libre vers la philosophie de ce profil pathétique de l’Histoire. Je ne veux pas prétendre que les circonstances soient les mêmes pour nous en ce moment. Mais il est vrai qu’il y a un rapport de convenance historique entre notre situation et la sienne. Et l’une et l’autre sont le développement de la guerre de 14, elles se tiennent. Ainsi puis-je retrouver cette assomption de son destin d’Allemand dans l’Allemagne misérable d’après-guerre pour m’aider à assumer mon destin de Français dans la France de 40.
Cette identification explicite du jeune Sartre avec le philosophe allemand est indéniable. C’est troublant, d’autant plus Sartre s’était rendu en Allemagne en 1933-34 pour y compléter ses études de philosophie à l’Institut Français de Berlin et que, par conséquent, il pouvait difficilement ignorer que Heidegger, recteur de l’université de Fribourg, avait adhéré publiquement au parti national-socialiste en 1933. Plus tard il prendra ses distances par rapport à l’auteur de Sein und Zeit, mais dans ses Carnets l’influence de la pensée heideggérienne est omniprésente. Parlant une fois de plus sur l’authenticité, dans le Carnet III (Sartre 1995, 254), le mardi 28 novembre, Sartre reconnaît ceci : « C’est vrai, je ne suis pas authentique. Tout ce que je sens, avant même que de le sentir je sais que je le sens. Et je ne le sens plus qu’à moitié, alors, tout occupé à le définir et à le penser… » Voilà le drame non seulement de Sartre, mais aussi le drame de tout intellectuel et, peut-être, celui de l’homme contemporain tout court. La pensée ne serait finalement qu’un obstacle, un piège, un gouffre qui nous sépare de toute sensation véritable, de tout véritable sentiment, nous empêchant, en fin de compte, de vivre avec plénitude, d’être authentiques. La pensée, activité, selon Heidegger, pleine de sens, de profondeur et de “gravité” à l’époque d’Héraclite, de Pythagore et de Parménide, est devenue un mécanisme incontrôlable, envahisseur et perturbateur de la conscience. « Penser et non méditer » propose Sartre le 18 septembre 1939 dans son Carnet I (Sartre 1995, 34), sans aller plus loin dans une exégèse qui aurait impliqué de sa part de s’intéresser à l’opposition entre le penser comme pratique occidentale et la méditation comme pratique orientale. C’est précisément sur cette dichotomie - l’opposition entre la culture de l’Orient et celle de l’Occident - que Gurdjieff développe son enseignement pour permettre aux Occidentaux d’appréhender, grâce à des méthodes adaptées aux mœurs occidentales, la sagesse millénaire de l’Orient. Leibniz et Schopenhauer, penseurs que Sartre respectait, s’étaient penchés sur le phénomène, ô combien mystérieux, d’une humanité divisée non seulement géographiquement, physiquement, mais aussi métaphysiquement. Or, ni la Monadologie ni Le Monde comme Volonté et comme Représentation ne réussissent à dépasser les limites de la pensée métaphysique, en dépit de la profondeur et de l’authenticité du travail intellectuel de leurs auteurs6. Alors, qu’est-ce penser ? Comment être authentique ? Pour Heidegger, nous avons oublié ce que signifie penser. Pour Sartre, l’homme contemporain demeure dans l’inauthenticité, envahi par une pensée qui l’empêche de sentir. Cela explique en grande partie le drame du protagoniste de La Nausée, Antoine de Roquentin, l’alter ego décapité de Sartre.
Si Sartre dans sa jeunesse reconnaissait volontiers l’autorité de Heidegger en tant que maître de la philosophie contemporaine, le Maître Absolu hégélien, la Mort et Dieu n’éveillent chez lui - même au seuil d’une guerre mondiale - que peu d’intérêt. Ainsi, parlant de Dieu, il classe l’affaire en deux pages du Carnet III (Sartre 1995, 267), le vendredi 1er décembre 1939 :
Un jour à la Rochelle, en attendant les demoiselles Machado qui faisaient route avec moi le matin quand j’allais au lycée, je m’impatientais de leur retard et, pour occuper mon temps, je m’avisais de penser à Dieu. “Eh bien! me dis-je, il n’existe pas”. Ce fut une authentique évidence, encore que je ne sache absolument plus sur quoi elle s’appuyait. Et puis ce fut fini, je n’y pensai jamais plus, je ne m’occupai pas plus de ce Dieu mort que je ne m’étais soucié du Dieu vivant. J’imagine qu’on trouverait difficilement de nature moins religieuse que la mienne. J’ai réglé la question une fois pour toutes à douze ans.
En ce qui me concerne (et l’anecdote est ici valable et nécessaire), j’ai réglé la question une fois pour toutes à cinq ans, mais dans le sens opposé : ma tante « Pochi » (tante adorée, qui m’avait appris à lire et à écrire et dont je guettais la nudité à travers la serrure de la salle de bains lorsqu’elle prenait sa douche) m’amena avec elle à l’église du quartier, l’église Saint Michel. Devant la façade se dressait un monument où l’on voyait le saint en train de terrasser, lance à la main, le pauvre Lucifer déguisé en dragon. Je voulus monter sur le socle du monument pour mieux apprécier le combat, mais Pochi s’y opposa vivement. Une terrible colère me saisit et je me mis à crier et à blasphémer, menaçant de mettre tout par terre, y compris la statue et l’église. « Dieu va te punir », me prévint Pochi, plutôt amusée. Quelques heures plus tard, au milieu de la nuit, un violent séisme secoua Santiago réveillant dans la panique tout le monde. « Je te l’avais dit ! », s’écria Pochi, me prenant dans ses bras pour me protéger des secousses. Depuis lors, je crois en Dieu définitivement, certitude dûment validée et tamponnée quelques années plus tard par la lecture des Méditations de Descartes. Et puis, comme pour Sartre, ce fut fini, je n’y pensais jamais plus.
Au mois d’avril 1969 mon problème était bien moins important que toutes ces questions métaphysiques et théologiques : Que faire de ma tentative scripturale ? Comment continuer à écrire ? Plongé dans l’incertitude et devant l’évidence de mon manque d’habilité, je décidai - moi, qui étais à la recherche de la liberté absolue - de faire acte d’humilité, de me soumettre et de suivre la voie tracée par les grands classiques. Écrivant La Curación, j’avais constaté que l’axe principal du texte était la communication établie entre le protagoniste psychotique et son psychothérapeute, entre l’homme obscur et dérouté, et l’homme qui - connaissant le chemin de la guérison - allait le conduire jusqu’au salut. Dans ma tête s’agitaient les images, les souvenirs et les idées. Où avais-je lu quelque chose de semblable ? Quel maître classique pouvait m’aider à sortir mon texte, confus et égaré, de l’impasse où il se trouvait ? Subitement, j’eus une véritable révélation : c’était Dante, c’était La Divine Comédie. Dante dans le rôle du patient égaré dans l’enfer de la maladie mentale et Virgile dans le rôle du médecin qui le conduira à la guérison, au Paradis, c’était le parallèle le plus parfait que j’eusse pu trouver pour développer mon propre texte. Ce faisant, j’empruntais la voie de Joyce suivant Homère, celle de Dante lui-même suivant Virgile, et celle de Virgile suivant à son tour Homère. Et de la même façon que Joyce soumit le texte d’Ulysses au texte de l’Odyssée, Dante celui de la Commedia à l’Énéide, et Virgile le texte de l’Énéide aux poèmes homériques, je fis le pari de soumettre le mien au poème du maître florentin, emporté par un sentiment à la fois poétique, magique et religieux. « Ce sentiment magique et religieux - écrit Sartre, avec une certaine ironie - est à l’origine du classicisme : le classique grave une maxime sur le mur, il l’enfonce dans la matière et puis il se plante devant et médite. Le classicisme c’est l’art des méditations dirigées. » (Sartre 1995, Carnet III, p. 289, dimanche 3 décembre 1939).
Voilà donc, ma voie textuelle enfin découverte. Maintenant, pour la parcourir jusqu’au bout, je devais m’équiper soigneusement.
(La Divine Comédie)
La Divine Comédie est le poème axial du christianisme, l’œuvre littéraire la plus parfaite de notre civilisation occidentale. Non seulement elle trace un tableau historique, politique et social très complet de son époque, tout en indiquant le chemin initiatique pour le salut de chacun, mais encore elle rationalise le mythe chrétien en lui donnant une structure poétique, de la même façon que les poèmes homériques rationalisent le mythe grec, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle dimension de la conscience humaine. D’un point de vue linguistique, la Divine Comédie fait évoluer le toscan de l’état de dialecte régional à celui de langue, langue qui deviendra le ciment de l’unité nationale de l’Italie. D’autre part, dans la mesure où elle introduit la subjectivité de l’auteur dans le texte lui-même, la Divine Comédie annonce la fin de l’épopée comme genre dominant depuis l’Antiquité et marque le début d’un nouveau type de littérature. Jusqu’à Dante l’épopée racontait - d’une manière impersonnelle, détachée de son objet - des faits plus ou moins étrangers, extérieurs à la vie du poète. Dante change le centre de gravité du texte épique en s’introduisant lui-même dans le récit, à la fois comme personnage et comme narrateur. Il est, en quelque sorte, le Copernic de la littérature.
C’est à peu près ce que je découvris en analysant la Divine Comédie, étude que j’entrepris à Florence, où - après mon séjour à Jávea - je m’étais rendu pour apprendre l’italien et travailler sur les versions les plus anciennes du poème, dans le contexte historique de celui-ci7. Je confirmai à quel point l’élément autobiographique est d’une importance décisive dans la construction du texte : outre le fait que la Divine Comédie est née d’un épisode délirant, mais réel, de la vie du poète, Dante y utilise constamment les données de son propre vécu comme soldat, médecin, diplomate et homme politique de haut rang. Et, malgré cette attitude égocentrique (mais nullement égolâtrique) le poète réussit à dépeindre, en la critiquant profondément, la société de son temps. Comme Sartre (et Proust), Dante aussi aurait pu dire de lui-même : « Ma passion, c’est moi ».
Tout en travaillant sur la Commedia, je continuai à écrire et à développer de nouvelles ébauches de La Curación. Je complétai le Retrato de un Psiquiatra (qui deviendra le Portrait d’un psychiatre incinéré) ce qui me rassura par rapport à ma vocation littéraire et j’acceptai pour toujours - grâce à l’écriture - que, même si j’avais pu accomplir la plus brillante des carrières comme psychiatre, cette voie n’était pas la mienne8. Par contre, en étudiant la vie et l’œuvre de Dante, je remarquai, encore une fois, l’importance décisive de la littérature authentique dans le développement de la conscience individuelle et de la vie sociale. Je dis bien « littérature authentique » car, en même temps que j’explorais la Divine Comédie, je lisais également les romanciers à la mode, dont les livres étaient vantés par la presse. Entre la profondeur, la luminosité et la perfection stylistique de l’œuvre de Dante, et la médiocrité criarde et confuse des best-sellers américains et européens, le contraste était frappant. Même le roman latino-américain, mis en vedette par le « Boom », n’était pour moi qu’un reflet lointain, caricatural, de cette littérature qui, par-delà les siècles, m’arrivait toujours vivante et fraîche, pure et incorruptible comme l’eau d’une source intarissable.
Comment expliquer cette fatalité qui fait qu’une culture splendide comme celle que je voyais se refléter dans les palais et les musées de Florence, s’écroule sous le magma obscur et nauséabond de la médiocrité la plus amorphe ? Cette question grandissait dans mon esprit tandis que je déambulais au milieu des touristes américains, entre la Casa di Dante, la Bibliotecca Laurenziana et ma pension au bord de l’Arno, à quelques pas du Ponte Vecchio. À côté de ma « pensione » il y avait une petite librairie où j’achetai l’un des best-sellers de l’année, Portnoy’s Complaint, roman de l’écrivain new-yorkais, Philipp Roth. C’est en lisant ce livre, qui raconte l’histoire d’une psychothérapie psychanalytique imaginée par le romancier, que je finis par comprendre que quelque chose de corrompu rongeait la littérature contemporaine en la dégénérant jusqu’en ses racines9. Et le véhicule de cette influence néfaste, complètement opposée à celle qui me parvenait à travers les cents Cantos de la Commedia accrochés - presque comme une curiosité - à l’entrée de la Casa di Dante, avait une forme littéraire bien spécifique : le roman. De plus en plus, le genre romanesque m’apparaissait comme une sorte de sac fourre-tout où l’écrivain, sous prétexte de la nécessité d’une totale liberté de son imagination « créatrice », se permet d’éjecter toutes les affabulations de son esprit en les façonnant dans le but, non de trouver et de transmettre une lumière quelconque à son lecteur, mais uniquement pour le chatouiller dans son sommeil et, surtout, gagner de l’argent.
Pour Sartre, l’argent, la « propriété », les objets n’avaient aucune importance. Dans son Journal, Carnet XII (Sartre 1995, 481), le samedi 24 février 1940, il affirme :
Je sens l’argent comme une puissance abstraite et fugitive, j’aime le voir s’évanouir en fumée et je suis dépaysé devant les objets qu’il procure. Jamais je n’ai rien eu à moi, dans la vie civile, ni meubles, ni livres, ni bibelots. Je serais très gêné dans un appartement, il se transformerait vite, d’ailleurs, en écurie. Je n’ai jamais eu à moi depuis dix ans que ma pipe et mon stylo. Encore suis-je gaspilleur même de ces objets-là : je perds les stylos et les pipes, je ne m’y attache point, ils sont en exil chez moi.
En vérité, le goût de propriété et de richesse chez Sartre était vraiment négligeable. Parlant de sa prédilection pour travailler dans les cafés, il raconte, toujours le 24 février (Sartre 1995, 483) :
J’aime que tous les objets soient à quelqu’un qui par ailleurs est mon ami et qui m’en laisse user dans une certaine mesure. À vrai dire je m’en lasse vite et ce que je préfère - ou du moins ce qui ne me lasse jamais -, c’est de m’asseoir sur des chaises qui ne sont à personne - ou à tout le monde, si l’on veut - devant des tables qui ne sont à personne. C’est pour cela que je vais travailler dans les cafés, j’atteins à une sorte de solitude et d’abstraction. Mais, de temps à autre, il me plaît de m’enfoncer dans cette chaleur lumineuse qui n’est pas à moi mais qui, un moment, est pour moi. Il ne fait aucun doute, cependant, que personne ne s’accommoderait mieux que moi d’une collectivisation de la propriété, car je n’y perdrais que le plaisir de donner -et encore pourrais-je donner de mille autres façons10.
Sartre, à la différence de Dante - qui à l’âge de trente-cinq ans fut contraint de subir un exil douloureux et définitif après la défaite de son parti, écrasé dans le sang par le pape Boniface VIII - vécut et travailla presque toute sa vie chez lui, à Paris. Pourtant, il y a dans sa façon de vivre quelque chose qui rappelle la sobre dignité dans laquelle se drapa le poète toscan jusqu’à la fin de ses jours. Toujours le 24 février 1940, à propos de son style de vie, il écrit (Sartre 1995, 485) :
Au fond, bien que mon beau-père me reproche chroniquement de vivre à l’hôtel, je vais dans le sens de toute ma famille : pas de biens, je n’attends pas d’héritage et je n’en laisserai pas, je ne possède pas la chambre où j’habite (…) En ce sens, arrière-petit-fils de paysans, petit-fils de fonctionnaires, je suis, fonctionnaire moi-même, collectivisé à un degré plus avancé. J’entends en ce qui concerne la propriété, car cette collectivisation matérielle a pour effet de renforcer chez moi l’individualisme et le goût de la liberté.
C’est vrai, en 1940 Sartre n’avait que trente-cinq ans et il habiterait plus tard dans un bel appartement à Saint-Germain-des-Prés, laissant à la fin de sa vie des droits d’auteur considérables à sa fille adoptive, Arlette Elkaïm-Sartre, compilatrice des Carnets de la Drôle de Guerre. Mais je crois que, compte tenu des excès du parisianisme, Sartre reste un modèle de simplicité. Je mets l’accent sur le style de vie de l’écrivain car en étudiant la vie et l’œuvre de Dante, j’avais constaté encore une fois l’étroite relation qui existe entre la créativité d’un écrivain et sa façon de vivre. La dialectique Vie/Texte, qui s’était révélée pour moi à Jávea comme le moteur de l’authenticité de l’écrivain, trouvait dans le parcours de Dante sa confirmation, mais aussi dans le parcours de tous les grands écrivains que je connaissais alors, notamment Joyce et Proust. Eh bien, il n’y a pas de rapport plus direct entre la vie et le texte chez un auteur, que lorsque celui-ci se penche sur sa propre vie, lorsque le texte d’un écrivain raconte - comme c’est le cas de la Recherche ou des Carnets - la vie de l’auteur, pas nécessairement la vie déjà passée, mais la vie qui est en train de se faire autour de l’écriture elle-même.
La Divine Comédie, en mettant fin à l’épopée grâce à l’introduction de l’auteur-narrateur dans son propre récit, ouvre le chemin pour un genre d’une qualité tout à fait différente de celle qui caractérise le roman d’aujourd’hui. Malheureusement l’impulsion dantesque fut très tôt déviée, avant même la fin de la Renaissance, avec l’apparition du roman de chevalerie dans lequel on remplaça l’élément autobiographique par une fausse biographie de telle façon que le narrateur - en étant encore plus éloigné de son texte que dans le cas de l’épopée - eût tout loisir d’inventer les personnages les plus « fabuleux », les péripéties les plus absurdes et invraisemblables, et cela dans le seul but d’amuser ou bien, de dissimuler une réalité honteuse. C’est contre cette aliénation que se dressa Cervantès au 17e siècle, mais le message anti-romanesque de Don Quichotte fut vite déformé, occulté et oublié.
À Florence, parallèlement à mon travail sur Dante, je poursuivais la lecture de Proust dans une très mauvaise traduction en langue espagnole. Cela ne m’empêcha pas d’établir la différence entre la Recherche et ce qui est considéré par les critiques les plus obtus comme l’un de ses prolongements : le Nouveau Roman. Je m’étonnais qu’on puisse voir chez Proust ou chez Sartre des précurseurs d’un nouveau style romanesque encore plus frivole que le roman américain des années 60 (Roth, Updike, le mirliflore Tom Wolfe, etc.) Les « nouveaux romanciers », Robbe-Grillet en particulier, se faisaient une joie non seulement de mettre en pièces ce qui restait de vraisemblable et de cohérent dans le roman moderne - celui de Sartre, mais aussi celui de Kafka, Beckett, Sarraute, Camus, Aragon, etc. - mais, de plus, ils n’accordaient aucune importance à l’histoire elle-même, proposant en revanche des textes d’une provocante inintelligibilité. Mais grâce à cet artifice, le nouveau romancier était enfin libéré de toute responsabilité vitale face à son œuvre, la dialectique Vie/Texte était cassée. Or, À la Recherche du Temps Perdu s’insère dans la même perspective séculaire que La Divine Comédie. Comme Dante, Proust est à la fois le narrateur et le personnage central de son œuvre, allant jusqu’à se nommer lui-même vers la fin de la Recherche, timidement, à l’égal du poète toscan au moment de sa rencontre avec Béatrice au Paradis Terrestre.
Je voyais donc, dans l’œuvre de Proust, une nouvelle tentative pour ramener la littérature dans la voie tracée par Dante préparant ainsi le dépassement du roman vers un nouveau genre narratif (dans le temps on parlera d’autofiction), où l’auteur n’est plus séparé de son texte. Et je ne comprenais absolument pas comment cette véritable révolution de la littérature, si coûteuse pour son auteur, qui écrivit enfermé dans une chambre les dix-sept dernières années de sa vie, avait été si vite récupérée et détournée au profit d’une littérature plus inauthentique que jamais. Il y avait là un nouveau mystère qu’il me fallait résoudre avant d’aborder la phase finale de La Curación et cela me décida, une fois terminée la lecture de La Divine Comédie, à quitter Florence et à me rendre à Paris pour y vivre et explorer en profondeur les dessous du Nouveau Roman. Ma recherche dans le chemin de la connaissance de la littérature continuait sans relâche… tout en étant loin de la quête de savoir de l’Autodidacte, l’autre alter ego de Sartre-décapité dans La Nausée, qui s’était proposé de lire par ordre alphabétique la totalité des livres de la bibliothèque publique de Beauville !
Sartre, parlant de son propre désir de connaissance, dit ceci dans son Carnet XII (Sartre 1995, 487), le samedi 24 février :
Je suis, moi individu, en face de la totalité du monde et c’est cette totalité que je veux posséder. Mais cette possession est d’un type spécial : je veux le posséder en tant que connaissance. Mon ambition est de connaître à moi tout seul le monde, non dans ses détails (science) mais comme totalité (métaphysique). Et pour moi la connaissance a un sens magique d’appropriation. Connaître, c’est s’approprier (…) Mais à cela la métaphysique ne suffit pas ; il faut aussi l’art, car la phrase qui capte ne me satisfait que si elle est elle-même objet, c’est-à-dire si le sens du monde y paraît non pas dans sa nudité conceptuelle mais à travers une matière. Il faut capter le sens au moyen d’une chose captante qui est la phrase esthétique, objet créé par moi et existant par soi seul.
Donc, Sartre - cet homme qui répugna toujours à la possession de biens matériels - exhibe ici - à la façon de Faust et son appétit de savoir absolu - le désir de posséder le monde par l’intellect et, à travers la connaissance, de devenir maître, dans le sens hégélien du mot, du monde comme totalité. À Jávea, j’avais effleuré dans La Sociedad de los Hombres Celestes la problématique faustienne de la soif de connaissance absolue, qui pousse le Docteur Faust au pacte avec Méphistophélès. Cependant, dans cette première version de La Curación, je ne m’étais pas encore aperçu des perspectives intertextuelles faustiennes de mon travail. C’est à Paris, beaucoup plus tard, que je pus approfondir le jeu intertextuel avec les multiples facettes de la légende de Faust, ce qui m’imposerait aussi l’étude de l’allemand. Pour sûr, en me rendant à Paris pour dominer le français et étudier dans la langue d’origine la littérature française du 20e siècle, je ne le faisais que pour mieux accomplir le « service-du-monde » et nullement pour m’approprier celui-ci.
La relecture de Proust, réalisée cette fois dans des conditions presque parfaites puisque - comme pour Dante à Florence - je pus connaître dans sa version originale l’ensemble de son œuvre en même temps que le contexte matériel et historique qui l’entoure, me permit de mieux saisir la littérature contemporaine. Proust, en se penchant sur sa propre vie, en décrivant sa subjectivité, décrit simultanément la société qui fut la sienne. Mais, en cherchant sa propre délivrance, il dévoila les mécanismes corrompus de cette société. C’est ce qu’il fera minutieusement tout au long des six premiers tomes de la Recherche, avant de déchiqueter, dans le dernier tome - Le Temps Retrouvé - cette même société dont il avait si brillamment tracé le portrait. Proust donc, est un écrivain révolutionnaire, non seulement d’un point de vue littéraire, mais aussi d’un point de vue sociologique et psychologique. Il est - j’insiste - révolutionnaire dans trois directions différentes. Littéraire d’abord, dans la mesure où il s’introduit dans son récit en tant que personne, changeant ainsi les données du roman balzacien et dépassant les limites de celui-ci en ayant recours à l’autofiction ; sociologique ensuite, dans la mesure où il dénonce et condamne l’organisation de la société en castes sociales, organisation dont il fut à la fois l’exégète et la victime ; psychologique, enfin, dans la mesure où il établit une remarquable phénoménologie du Moi (les « Je » multiples), une sorte de psychologie relativiste qui va très au-delà de la psychanalyse freudienne et s’approche, par contre, de la psycho-dynamique gurdjieffienne.
Comme chacun sait, Proust - Juif et petit-bourgeois « jeté-en-situation » au milieu de l’aristocratie française raciste et élitiste - paya très cher l’authenticité de sa démarche. Après avoir essuyé de multiples refus de la part des éditeurs (les mêmes qui refuseraient stupidement Sartre à ses débuts, lui imposant des conditions humiliantes pour l’éditer11) il dut se résigner à publier à compte d’auteur le premier tome de la Recherche. Et même, lorsque plus tard le second tome - À l’Ombre des Jeunes Filles en Fleur - fut reconnu par la critique et le jury qui lui attribua le prix Goncourt, il continua à vivre dans un isolement presque total, n’attachant aucune importance véritable à une reconnaissance tardive, beaucoup plus mondaine que littéraire. Sans doute son isolement et la mort qui s’ensuivit furent le prix ultime que l’écrivain dut payer pour ne pas se trahir lui-même et son œuvre. Comme le montre la Recherche, il était intolérable pour son créateur de rester attaché par mille compromis hypocrites à une structure sociale dont il avait entrepris la dénonciation. D’ailleurs, si Proust se laissa mourir immédiatement après avoir fini la Recherche, juste avant la publication de Sodome et Gomorrhe, ce fut - j’en suis convaincu - dans un élan final de liberté face à cette société de castes qu’il détestait. Marcel Proust était un écrivain dont la vie et l’œuvre furent en correspondance dialectique serrée. Comment donc comprendre le fait que son exemple ait été si rapidement détourné ? Je crois qu’à cet égard Jean-Paul Sartre, dont l’escamotage de l’importance de l’œuvre proustienne est frappant, porte une certaine responsabilité.
Il est vrai que réduire l’œuvre de Proust à une position révolutionnaire scientifique est sans doute excessif. Si je fais ce rapprochement entre Sartre et Proust, c’est aussi parce que ce dernier réussit ce que le premier n’obtint pas : l’accomplissement d’une œuvre littéraire harmonieuse, en rapport étroit avec un style de vie sans concessions au « monde ». Proust était, au fond de lui-même et face à son œuvre, profondément sérieux. Dans le Carnet I (Sartre 1995, 45), le samedi 23 septembre 1939, Sartre fait nettement la différence entre écrire des livres et développer une œuvre : « J’ai toujours conçu mes écrits non comme des productions isolées mais comme s’organisant en une œuvre. Et cette œuvre tenait dans les limites d’une vie humaine. » C’est peut-être bien dit, mais mal accompli car, comparé à l’engagement vital de Proust dans la littérature, Sartre manque décidément d’organisation, de sérieux, comme le prouve le nombre considérable d’ouvrages qu’il laissa sans terminer : Les Chemins de la Liberté, tétralogie qui finit comme trilogie, La Critique de la Raison Dialectique, dont la suite annoncée ne vit jamais le jour et, vers la fin de sa vie, L’Idiot de la Famille, analyse existentielle de la vie et de l’œuvre de Gustave Flaubert, analyse qui resta, elle aussi, inachevée.
En mars 1940, dans son Carnet XIV, Sartre avait fait une première tentative d’analyse existentielle d’un personnage historique. Il s’intéressa (comme il le fera plus tard avec Flaubert, au lieu de s’intéresser à Proust) à l’empereur Guillaume II. Suivant une méthode qui se veut entièrement différente de la méthode historique classique, mais surtout du matérialisme historique marxiste et de la psychanalyse freudienne, il essaya d’expliquer l’influence de l’atrophie congénitale du bras gauche de l’empereur et de sa qualité de petit-fils de la reine Victoria d’Angleterre dans le déclenchement de la première guerre mondiale. Je simplifie à l’extrême une analyse qui prend des dizaines de pages du Carnet XIV (Sartre 1995, 553), dont voici un court extrait qui me semble significatif de la pensée philosophique du jeune Sartre :
La royauté est - comme Heidegger le dit du monde - ce par quoi le futur souverain se fait annoncer ce qu’il est. Il m’apparaît donc que la liberté première de Guillaume II s’appelle royauté. D’ailleurs la liberté intervient encore dans la manière d’être-pour-régner. (…) Il ne fait que donner une expression mythique à ce fait que, seul parmi les hommes, son être est un être-pour-régner. Il “est” le règne. Et ceci, il le constate dans son être, sa compréhension pré-ontologique de soi coïncide avec le pro-jet de soi-même vers le couronnement12…
L’analyse existentielle de la personnalité est sans doute séduisante, surtout à l’intérieur de la psychiatrie, mais son application à l’histoire et à la littérature donne comme résultat une vision subjectiviste et psychologiste des événements, vision qui - comme le montre l’analyse de Guillaume II - n’est pas très sérieuse et pas du tout révolutionnaire. Le jeune Sartre, encore conditionné par sa situation d’intellectuel petit-bourgeois, ne fait rien d’autre que substituer au matérialisme historique une interprétation métaphysique et individualiste de l’Histoire. Sa pensée ne lui sert, dans ce cas spécifique, qu’à occulter une certaine mauvaise conscience en le confinant dans l’inauthentique. Or, s’agissant de son rapport à Proust, je crois que cette « mauvaise conscience » est aussi présente. Autrement, comment expliquer son immense effort pour écrire L’Idiot de la Famille, véritable Tour de Babel funéraire dressée à la mémoire de Flaubert, tandis que Proust ne mérite pratiquement pas son attention ? D’ailleurs, à l’époque de la Drôle de Guerre, Sartre n’aimait pas Flaubert. Ainsi, parlant du romancier normand le dimanche 6 décembre 1939, dans son Carnet III (Sartre 1995, 304), il avoue ceci :
Je lisais pendant les rares moments de répit “L’Éducation sentimentale” de Flaubert. Que c’est maladroit et antipathique. Quelle sottise, cette hésitation constante entre la stylisation dans les dialogues et les peintures et le réalisme. Une histoire piteuse gravée dans du marbre. On voit Zola qui perce à travers un style parnassien et mastoc. Jusqu’ici c’est d’ailleurs parfaitement stupide : sans une impression, sans une idée, sans un caractère, sans même ces remarques historiques dont Balzac est capable. Ses descriptions ne peignent pas. La phrase est lourde et embarrassée (…)
À mon avis, Sartre est sincère dans ses propos sur une œuvre que, personnellement, je n’aime pas non plus, pour les mêmes raisons. Alors, pourquoi élever un monument à un auteur qu’il dédaigne ? Quant à Proust, il l’évacue à la même date, sans ménagement :
La psychologie d’introspection me semblait avoir donné son meilleur avec Proust, je m’y étais essayé entre 17 et 20 ans avec ivresse, mais il m’avait semblé qu’on passait maître fort vite à cet exercice et que d’ailleurs les résultats étaient assez monotones. (Sartre 1995, Carnet V, p. 351, mardi 19 décembre 1939).
Et dans son essai sur Husserl, qu’il rédigea cette même année 1939, il exulte :
[…] Nous voilà délivrés de Proust. Délivrés en même temps de la “vie intérieure” […] Ce n’est pas dans je ne sais quelle retraite que nous nous découvrirons : c’est sur la route, dans la ville, au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes. (Sartre 1947, 31‑32)
Ce faisant, il ne verra pas que la Recherche n’est pas un roman traditionnel, mais un texte qui prélude, grâce à l’autofiction (comme l’Ulysses de Joyce, grâce à l’intertextualité), un nouveau genre narratif.
C’est toujours amusant d’analyser Flaubert, mais - étant donné les mouvements révolutionnaires qui ont marqué le début de notre siècle - Proust me paraît encore plus intéressant. Cela n’a pas pu échapper à Sartre. Pourquoi donc choisit-il d’exercer sa formidable capacité d’analyse sur un écrivain du 19e siècle, dont l’idéologie bourgeoise, tout comme son œuvre, avaient été déjà largement étudiées ? Sans doute à cause de l’ambiguïté idéologique de Sartre, ambiguïté qui - malgré sa reconnaissance du marxisme, en particulier dans La Critique de la Raison Dialectique - dura jusqu’à la fin de ses jours. Mais il y a d’autres raisons plus subjectives qui expliquent aussi pourquoi Sartre néglige l’œuvre de Proust. Le 11 mars 1940 il écrit dans son Carnet XIV (Sartre 1995, 557) :
Mais j’étais athée par orgueil. Non par sentiment d’orgueil, mais mon existence même était orgueil,_j’étais_ l’orgueil. Il n’y avait point de place pour Dieu à côté de moi, j’étais si perpétuellement la source de moi-même que je ne voyais pas ce que serait venu faire un Tout-Puissant dans cette histoire…
Or s’il n’y avait pas de place pour Dieu à côté de Sartre, il y en avait encore moins pour tout autre écrivain de son siècle, même s’il avait l’importance de Marcel Proust. Jean Genet passe encore, puisqu’il était un écrivain relativement marginal, mais déjà Albert Camus, prix Nobel avant lui, avait eu droit à ses foudres, à l’instar de Breton et ses compagnons surréalistes, apparentés au Klu-Klux-Klan. Pour sûr, il n’est pas question de condamner Sartre pour une attitude somme toute très humaine, mais nous pouvons quand même la regretter. S’il avait analysé l’œuvre de Proust avec la même puissance qu’il employa pour explorer celle de Flaubert, la littérature française ne serait peut-être pas tombée dans le piège du Nouveau Roman et de son rejeton, le roman Tel Quel.
(Sartre / pensée / méditation)
À Paris, tandis que je complétais ma lecture de Proust, je travaillais parallèlement sur mes Cahiers de vie, étude autobiographique qui compta jusqu’à six cahiers et environ un millier de pages. Je voulais, outre améliorer mon style et développer une capacité « physique » d’écriture (six heures ininterrompues par jour), mieux comprendre l’autofiction proustienne, si imprégnée de réminiscences biographiques et, en même temps, si éloignée d’une simple autobiographie. Je me rappelle encore le choc que j’éprouvai lorsque je me rendis à Illiers-Combray pour visiter la maison de la tante Léonie et découvrir la promenade que faisait le petit Marcel pour se rendre au jardin du Pré Catelan. Je n’arrivais pas à croire que cette maison banale et ce village moins beau que beaucoup d’autres perdus dans ce coin de la Beauce étaient les mêmes lieux si merveilleusement textualisés dans la Recherche. La chambre à coucher de Proust et la lanterne magique correspondaient à ce que j’avais imaginé en lisant Du Côté de chez Swann, mais il y avait une si grande différence entre la textualisation de cette réalité et la réalité elle-même, que je ne pus que m’incliner devant une certitude désormais aussi émotionnelle qu’intellectuelle : le regard de l’artiste transforme la réalité au point d’en créer une autre soumise à ses propres lois. Cette constatation tellement simple et évidente en apparence, vint résoudre d’un seul coup tous les scrupules et les doutes que je nourrissais encore à l’égard du « réalisme », décrié par les nouveaux romanciers et leurs suiveurs. Proust me montrait que la littérature n’était pas du tout une question de pure fantaisie, d’imagination débridée, de fabulation, de mensonge vrai ou de mensonge faux ou, encore moins, d’une fiction conçue comme une structure purement linguistique, à la façon du roman Tel Quel. Non, Proust me confirmait que la littérature en tant qu’art est, avant tout, une certaine façon d’atteindre la conscience et de la transmettre. Sartre, dans L’Imaginaire, ouvrage de jeunesse rédigé peu avant les Carnets, distinguait la « conscience imageante » de la « conscience réalisante », concepts qui expliquent le phénomène esthétique tel que je l’avais vécu à Illiers-Combray. Cette présence éblouissante d’une conscience qui se dévoilait devant moi au fur et à mesure que je lisais la Recherche, m’émerveillait jusqu’à me faire croire à deux réalités distinctes : celle du texte (l’analogon sartrien, « irréel ») et cette autre -morne et banale- signifiée par le texte (le « réel »). Cependant, comme j’allais l’expérimenter en développant mes Cahiers de Vie, la réalité ne serait qu’un seul et même mouvement, à la fois impalpable et matériel allant et venant entre le sujet et l’objet et trouvant sa matérialisation dialectique la plus haute dans l’écriture et, simultanément, dans la conscience de l’écrivain. « Je n’essaye pas de justifier ma vie après coup par ma philosophie, ce qui est salaud, ni de conformer ma vie à ma philosophie, ce qui est pédantesque, mais vraiment vie et philosophie ne font plus qu’un », note Sartre dans le Carnet IV (Sartre 1995, 635) (perdu, daté du 15 janvier 1940, partiellement repéré dans les lettres au Castor). « Vie et littérature ne font qu’un », pourrait-on dire de Proust et la Recherche.
Quant à ses positions strictement sociopolitiques pendant « la drôle de guerre », Sartre est plutôt ambigu. Malgré sa sympathie envers les ouvriers, il ne réussit jamais à surmonter, dans son existence même, sa situation d’écrivain bourgeois. Cette ambiguïté - d’un côté la fascination que la force des ouvriers exerce sur lui, de l’autre la répulsion qu’il éprouve face à leurs mœurs - nous la trouvons reflétée dans les Carnets de la Drôle de Guerre à la dernière page des fragments :
Grande conversation hier soir avec Grener. Avec ce gros homme brutal et grossier, qui rote et pète comme il respire, je fais la putain parce qu’il est ouvrier. Avant-hier soir, écrasé de sommeil et d’alcool, il ronflait sur un banc, tandis que j’écrivais. Tout d’un coup il se lève, les yeux roses, ni endormi ni réveillé, fou, se tourne contre le mur, déboutonne sa braguette et pisse. Je me précipite : " As-tu fini, espèce de salaud." Il grommelle “Ferme çà” (…) Malgré une certaine répugnance physique pour son odeur et sa graisse, je veux lui plaire et j’y réussis d’ailleurs sans peine, car il est flatté que je lui parle (…) De temps en temps il boit du vin rouge et sa véhémence s’accroît. Je n’ai pas de peine à l’écouter, d’ailleurs : il m’intéresse (…) Je sens très fort sa fierté d’être entouré d’objets qui lui doivent leur existence, qu’il a directement ou indirectement produits par la force de ses bras ; et aussi son sentiment de sécurité vis-à-vis des coups durs: il s’en tirera toujours, parce qu’il peut faire n’importe quoi… (Sartre 1995, Carnet XIV, p. 617, le jeudi 28 mars 1940).
On comprend mieux la cause du chemin en zigzag de Sartre par rapport à son engagement politique après la guerre. Il veut s’identifier à la classe ouvrière, mais il n’y arrive pas : il est trop cultivé, trop intellectuel, trop élégant pour parvenir à cette identification. Et puis, il y a sa compagne de toujours, le Castor, Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, demoiselle rangée et distinguée, issue de la meilleure bourgeoisie catholique française13. Du même coup, on saisit sa démarche littéraire par rapport au roman. Il sait que l’art romanesque est devenu un art éminemment bourgeois, mais si par souci d’authenticité il cesse d’écrire des « romans traditionnels », il ne renie pas le genre pour autant. Et il cherche à faire la révolution là où il avait le moins de chances de réussir - dans la rue - au lieu de l’entreprendre dans son propre domaine : la littérature.
Sartre, qui abandonna l’écriture des romans après La mort dans l’âme (publié en 1949), est parfaitement conscient du fait que le roman, en tout cas le roman traditionnel (c’est-à-dire, le roman de personnages à la Stendhal, à la Balzac) est une forme devenue obsolète, insuffisante et inadéquate à l’évolution de la société et de l’individu. Parlant de l’œuvre d’art dans L’Imaginaire, il reconnaît que la question dépend, précisément, de l’imaginaire et qu’il faudrait « pour en traiter, écrire un ouvrage spécial ». C’est ce qu’il n’a pas fait concernant l’art du roman, il ne s’est pas donné la peine, malheureusement pour nous, de développer une analyse systématique et exhaustive du genre romanesque et du phénomène de la fiction. S’il avait théorisé sur le roman avec la même rigueur conceptuelle qu’il exerça dans L’Imaginaire, il n’aurait pas affirmé, dans son Carnet VIII (Sartre 1995, 632), le 9 janvier 1940, faisant preuve d’un étonnant simplisme, ceci : « Je sais bien qu’on ment tout le temps dans un roman. Mais du moins on ment pour être vrai. Et il me semble que tout le roman est un peu un mensonge gratuit ». On pourrait rétorquer que la fiction, l’une des fonctions fondamentales de notre psyché, abusivement identifiée au roman et au mensonge, n’est ni vraie ni fausse, ni sincère ni mensongère, ni réelle ni irréelle, la fiction est, tout simplement14.
Toutefois, influencé par la littérature anglo-saxonne, Sartre va proposer une nouvelle forme littéraire inspirée non pas de Joyce (il apprécie la technique du monologue intérieur dans Ulysses, négligeant néanmoins l’intertextualité avec l’Odyssée), mais des romanciers américains, Faulkner et Dos Passos. Cette nouvelle forme narrative est fondée sur la biographie, l’autobiographie, le reportage journalistique, la monographie historique (le portrait d’un individu doit receler en lui-même le mouvement totalisateur du temps historique), la théorie de la révolution (socialiste, bien entendu) et l’analyse existentielle, le tout soumis à sa méthode « progressive régressive » : le singulier portant en soi l’universel, ou inversement, l’universel saisi au cœur même du singulier. Et il assignera aux romanciers des nouvelles générations la tâche redoutable de faire passer la technique romanesque de la « mécanique newtonienne à la relativité généralisée », tout en insistant sur leur devoir de s’engager dans les transformations nécessaires à la société. L’exemple concret de cette nouvelle forme romanesque serait L’Idiot de la Famille, publié en 1971. Sartre voulait que cet ouvrage soit considéré comme un « vrai roman » : « Pour ma part, je trouve (cette forme) dans mon travail sur Flaubert, qu’on peut d’ailleurs considérer comme un roman. Je souhaite même que les gens disent que c’est un vrai roman » (Sartre 1947, 123). Il a sans doute raison. Mais « vrai roman » ou « roman vrai », on est toujours dans le cercle, ô combien vicieux, du roman.
Comment sortir de ce cercle vicieux et réintégrer ce que Klee et Kandinsky appellent, dans leurs théories sur l’art, une « spirale de vie » ? La réponse viendrait pour moi plus tard, avec ce que j’appellerai « l’Intertexte ».
J’avais mis environ trois ans pour délimiter le terrain du texte de La Curación. Toujours fidèle à mon projet joycien de mettre en rapport intertextuel La Divine Comédie avec mon propre récit, j’attribuai le rôle de Virgile au psychiatre et le rôle de Dante au psychotique, lequel dans son délire se prend pour Dante réincarné avec la mission d’écrire une nouvelle Divine Comédie15. Sur un niveau textuel, c’est le poème sacré qui sert de guide, de « thérapeute » au texte égaré, « malade ». Et, d’un point de vue hégélien, l’opposition des deux textes reflète la lutte des deux consciences de soi opposées, mon texte s’inclinant et se soumettant à celui de Dante pour - grâce à mon travail d’écriture - parvenir à son épanouissement absolu. Le résultat de ce processus, qui allait durer encore de nombreuses années, se trouve dans Les Phases de la Guérison, cycle de cinq livres : Le Baptême, Le Rêve, Portrait d’un Psychiatre Incinéré, La Société des Hommes Célestes et La Guérison. C’est dans le déroulement de cette pentalogie que se structure la critique du roman comme genre narratif (« newtonien »), générant une nouvelle forme, l’Intertexte (« relativité généralisée »), dont l’apparition est étroitement liée à l’invention de l’écriture électronique, fait historique que Sartre n’eut pas le temps d’apprécier dans toutes ses dimensions, notamment en ce qui concerne l’évolution de la littérature. Je tente de définir ce nouveau genre dans plusieurs de mes essais, parmi eux Bakhtine, le roman et l’intertexte ; Éditorialisation et littérature/Du roman à l’intertexte ; Dialogue intertextuel avec Bakhtine et aussi dans La Société des Hommes Célestes (un Faust latino-américain)16.
Pour conclure, je reviens à la question sur l’authenticité et la pensée, question qui sert de pont entre la littérature et la philosophie à l’intérieur de l’œuvre sartrienne. « Penser et non méditer », proposait Sartre sans approfondir ce qu’il entend par « méditer ». Il est permis de supposer qu’à cet égard son concept de la méditation était beaucoup plus proche des « méditations » cartésiennes que de la méditation comprise et pratiquée en Inde, au Tibet ou au Japon. Sartre est conscient que la pensée est davantage un obstacle qu’une aide pour être. Je parle de cette pensée mécanique, purement associative et incohérente, s’agitant automatiquement dans notre cerveau ensommeillé et à laquelle, par tradition et par inertie, nous accordons une place prédominante dans notre existence. L’écriture permet de réduire l’incohérence de cette pensée ordinaire, automatique au même degré que les activités physiologiques de notre corps (cardiaques, respiratoires, digestives, etc.) et de lui donner une forme, une direction. Dans ce même Carnet I (Sartre 1995, 75), le lundi 2 octobre, Sartre s’interroge : « Faut-il penser en écrivant ou écrire ce qu’on a pensé ? Penser en écrivant, c’est-à-dire préciser et développer un thème la plume à la main : on risque de se forcer, on devient insincère. » Et dans le Carnet II (Sartre 1995, 621), le 26 octobre 39, il ajoute : « J’ai des tas d’idées en ce moment et je suis bien heureux de tenir ce petit carnet, car c’est lui qui les fait naître ». Et encore, le 14 décembre (Sartre 1995, 626) : « J’ai bien vu, en écrivant, comme je pouvais concevoir une théorie par minute au temps de ma folle jeunesse… » Cette « pensée scripturale », pratiquée sans discontinuer par Sartre tout au long de sa vie d’écrivain, est certainement l’un des moyens indispensables de la littérature « authentique ».
Le vendredi 13 octobre 39, dans son Carnet I (Sartre 1995, 128), Sartre note, parlant de son orgueil d’être et du Cogito cartésien :
J’ai même parfois l’impression d’être au-dessous de mon exigence en m’attribuant du génie. C’est déjà déchoir que de m’en contenter. Cet orgueil, en fait, n’est pas autre chose que la fierté d’avoir une conscience absolue en face du monde (…) Je suis orgueilleux d’être une conscience qui assume sa condition de conscience humaine ; je suis orgueilleux d’être un absolu. Et cet orgueil avisé s’est du coup mis hors d’atteinte. Celui qui est vain de ses qualités “mondaines”, de sa force, de sa beauté, de son intelligence et même de sa vertu, est sujet au désespoir et à l’humilité parce que, du même coup, il accepte la comparaison et le jugement d’autrui (…) Mais moi je ne suis jamais humble, jamais désespéré parce que je ne suis pas fier de moi mais orgueilleux de ma conscience -exactement au niveau du Cogito cartésien. Un orgueil qui n’est pas séparable de l’être, de l’assurance absolue d’être. Un orgueil qui est ma façon d’être.
Sartre, à la fois immense génie et homme platement commun, signale où se trouve le pharmakós de l’angoisse métaphysique qui le ravageait lorsqu’il écrivit La Nausée, dont la lecture me permit de prendre moi-même conscience de sa dimension profondément humaine et universelle et d’initier mon chemin personnel vers la guérison. Cependant, son orgueil d’être « une conscience qui assume sa conscience d’être une conscience humaine », sentiment qui rappelle celui éprouvé et décrit par quelques grands poètes mystiques d’Orient et d’Occident - Krishnamurti, Pessoa, Eckhart - reste nécessairement un sentiment contingent, fragile, fugitif, éphémère. Il continue à dépendre de la pensée associative, perpétuellement instable et qui peut prouver tout et son contraire. Cette même pensée qui n’empêcha pas le très raffiné et sophistiqué Heidegger de fermer les yeux devant la grossièreté intellectuelle et la bestialité meurtrière du national-socialisme hitlérien. Et à Sartre, de fermer les yeux devant la négligence étique de Heidegger. Par contre, le sentiment de plénitude qui englobe simultanément la pensée ordinaire et la sensation du corps et du monde en les néantisant (pour utiliser ici un terme cher à Sartre), est une réalité à laquelle on peut accéder - volontairement - par la vraie méditation, celle qui n’est pas un simple discours dans notre cerveau, ni la conséquence d’un quelconque orgueil, mais le fruit d’une discipline particulière fondée sur l’attention en tant qu’énergie psychique et non comme mécanisme d’analyse conceptuelle. Sartre lui-même a effleuré spontanément ce sentiment de plénitude (proche peut-être des légendaires “extases” de Socrate, racontés par Platon), comme il le note dans son Carnet I (Sartre 1995, 41), le jeudi 21 septembre, 1939 :
Là, j’ai eu ce moment que j’attendais et qui est si particulier chez moi. Je ne saurais l’appeler extase, ni regret. C’est une espèce de nostalgie heureuse et poétique du nécessaire et de la grandeur. Nostalgie car la grandeur et la beauté (comme nécessités dans le cours de la vie) sont toujours par-delà ce qui m’entoure. Bonheur, car c’est tout de même un état contemplatif (…) Dans cet état que je ressens, il y a l’impression muette que je suis privé actuellement de grandeur et de beauté mais que pour le désirer tant, je les mérite et qu’un jour viendra où je les obtiendrai. Naturellement rien de tout cela ne se formule, c’est entr’aperçu par-delà les choses qui m’entourent et cela ne se dégage pas de ces choses mêmes. Et quand cela disparaît, je me retrouve sec. Je dois dire que cette impression paraît toujours sur un fond de mauvais goût. ( …) Je ne me dissimule jamais que l’humus sentimental sur lequel se développe cette impression qui m’est si chère ne vaut rien. Mais je ne crois pas que la valeur de l’état lui-même en dépende : il s’en dégage et n’en reste pas marqué. À ce moment-là je me sens poétique, encore que ce soit un état en repos et non créateur – du type intuition (moins la plénitude). Si le mot n’était si ridicule, je dirais que je me sens parfumé.
Sartre est-il parvenu à la grandeur, à la beauté ?
Sans aucun doute.
Pour mettre fin à ce dialogue intertextuel avec Sartre, sans trahir son optimisme métaphysique, je me permettrais d’ajouter : penser, mais aussi méditer. En tout cas, la littérature authentique - dont La Nausée et Les Chemins de la liberté sont un paradigme précieux - est celle qui cherche, découvre et signale les chemins qui peuvent mener le lecteur/écrivain vers la grandeur, vers la beauté.
Bibliographie
Dante Alighieri. 1987. La Divine comédie. Paris: Cerf.
Dostoyevsky, Fyodor. 1992. Les carnets du sous-sol. Babel (Arles, France) ; 40. Arles: Coédition Actes Sud-Labor-L’Aire.
Gac, Roberto. 1999. Portrait d’un psychiatre incinéré. Paris: La Différence.
Gac, Roberto. 2006. La Sociedad de los Hombres Celestes. Paris: Sens public.
Gac, Roberto. 2012a. « Bakhtine, le roman et l’intertexte ». Sens Public. /article1007.html.
Gac, Roberto. 2012b. Dialogue intertextuel avec Bakhtine: A propos de la mort du roman. CreateSpace Independent Publishing Platform.
Gac, Roberto. 2016. « Éditorialisation et littérature ». Sens Public, mars. /article1185.html.
Gac, Roberto. 2017. La Curacion. CreateSpace Independent Publishing Platform.
Joyce, James. 1916. A Portrait of the Artist as a Young Man. New York: B. W. Huebsch.
Joyce, James. 1922. Ulysses. Paris: Shakespeare; Company.
Joyce, James. 1944. Stephen Hero. London: Jonathan Cape.
Ouspensky, Piotr Demianovich. 2003. Fragments d’un enseignement inconnu. Paris: Stock.
Proust, Marcel. 1919. À la recherche du temps perdu. Paris: Gallimard.
Roth, Philip. 1969. Portnoy’s complaint. New York: Random House.
Sartre, Jean-Paul. 1940. L’imaginaire: psychologie phénoménologique de l’imagination. Bibliothèque des idées. Paris: Gallimard.
Sartre, Jean-Paul. 1943. L’être et le néant: essai d’ontologie phénoménologique. Bibliothèque des idées. Paris: Gallimard.
Sartre, Jean-Paul. 1945a. L’âge de raison. Chemins de la liberté ; 1. Paris: Gallimard.
Sartre, Jean-Paul. 1945b. Le sursis. Chemins de la liberté ; 2. Paris: Gallimard.
Sartre, Jean-Paul. 1947. Situations. Paris: Gallimard.
Sartre, Jean-Paul. 1949. La mort dans l’âme. Chemins de la liberté ; 3. Paris: Gallimard.
Sartre, Jean-Paul. 1959. La nausée. Paris: Livre de poche.
Sartre, Jean-Paul. 1964a. Les mots. Collection Soleil. Paris: Gallimard.
Sartre, Jean-Paul. 1964b. Qu’est-ce que la littérature? Paris: Gallimard.
Sartre, Jean-Paul. 1971. L’idiot de la famille: Gustave Flaubert de 1821-1857. Bibliothèque de philosophie. Paris: Gallimard.
Sartre, Jean-Paul. 1985. Critique de la raison dialectique. Bibliothèque de philosophie (Gallimard (Firme)). Paris: Gallimard.
Sartre, Jean-Paul. 1995. Carnets de la drôle de guerre: septembre 1939-mars 1940. Nouv. éd. augm. d’un carnet inédit.. Paris: Gallimard.
Toutes les citations des Carnets ont été extraites des éditions de 1983 et de 1995, Nrf, Gallimard. ↩
Le Vatican avait mis l’œuvre de Sartre à l’Index. À la porte des églises on trouvait la liste des livres interdits, La Nausée en bonne place.↩
Le substantif allemand « Selbstbewusstsein » est étymologiquement très dense. « Selbst » (même, soi-même, lui-même), « bewusst » (conscient), « Sein » (être) structurent un mot unique -Selbstbewusstsein- « autoconscience » en français… terme que l’Académie française n’incorpore toujours pas dans son dictionnaire. Traduire « Selbstbewusstsein » par « conscience de soi » est incorrect d’un point de vue hégélien, car dans Die Phänomenologie des Geistes la « conscience de soi » n’est que le point de départ vers la « Selbstbewusstsein ». Si le mot « autoconscience » n’est pas officiel en France (en espagnol on peut dire “autoconciencia”), il est de plus en plus utilisé, imposé par les circonstances. Et si le terme « autoconscience » est toléré, « autoconscient » doit l’être aussi.↩
C’est à peu près ce qu’affirme Bakthine dans sa théorie du roman.↩
Voir Ouspensky (2003). Dans cet ouvrage Ouspensky décrit minutieusement la psychodynamique gurdjieffienne, fondée sur l’existence chez l’homme de cinq centres psychiques -intellectuel, émotionnel, moteur, sexuel et végétatif- à la fois autonomes et interactifs. Il décrit aussi le centre émotionnel supérieur et le centre intellectuel supérieur, qui ne peuvent entrer en contact avec les centres inférieurs que si ceux-ci travaillent harmonieusement entre eux. La psyché est conçue -matériellement- comme une machine très complexe qu’il faut connaître en profondeur pour la manier efficacement.↩
Schopenhauer voulait mettre fin définitivement au problème de la métaphysique en développant son concept de la volonté, qu’il définit comme étant identique en tout point au corps. Or, lorsqu’on s’attend à une sortie définitive de la pensée conceptuelle pour aller vers la sensation, il retombe dans la métaphysique en décrivant la volonté en tant que… concept. (Le monde comme volonté, livre II, 18). Voilà la métaphysique repartie pour un tour ! Quant à Leibniz, il faut rappeler que les 64 hexagrammes oraculaires du Yi-King, le livre sacré de la Chine ancienne, lui ont permis de confirmer et d’affiner son arithmétique binaire, fondement du calcul infinitésimal et de la cybernétique d’aujourd’hui.↩
Bien sûr, je me suis demandé pourquoi Joyce, qui connaissait bien l’italien et à peine le grec, s’intéressa à L’Odyssée et non à la Commedia pour son travail intertextuel. Je pressentis que, très probablement, sa formation dans un lycée jésuite irlandais (Joyce faillit entrer au séminaire) avait été un barrage infranchissable pour lui, puisque l’œuvre de Dante contient une dénonciation sans complaisances des méfaits du catholicisme et des crimes de la papauté. Joyce n’eut pas la chance de connaître Sartre et La Nausée, ce qui lui aurait peut-être permis de dépasser ses conditionnements de petit-bourgeois catholique…↩
Le protagoniste du Portrait, Francisco Aragon Vinteuil, à l’instar de Dick Diver, le psychiatre-dandy de Tender is the Night (l’œuvre maîtresse de Scott Fitzgerald), fonde aussi une clinique psychiatrique, mais il va surtout concevoir une psychiatrie révolutionnaire, postfreudienne.↩
La scène est fameuse où une jeune américaine défèque sur une table en verre pour permettre à son partenaire de se masturber en la regardant par-dessous la vitre, scène romanesque située dans un hôtel de luxe, près du Duomo de Florence. La critique mondiale applaudit sans retenue le romancier, devenu richissime par la suite.↩
Gurdjieff, qui à la même époque écrivait de préférence au Café de la Paix, place de l’Opéra, aurait été totalement d’accord avec lui.↩
Parmi eux, Gaston Gallimard, très apprécié par les pétainistes et l’Occupant nazi. Paul Nizan, qui travaillait pour la Nrf, eut le plus grand mal à lui faire accepter le manuscrit de La Nausée. En échange, Gallimard imposa à Sartre d’éliminer le titre original –Mélancholie – générateur poétique du texte et homonyme de celui de la célèbre gravure de Dürer et lui demanda de supprimer une soixantaine de pages, trop proches du « petit peuple » pour son goût d’éditeur. (Cf, Michel Contat, Item, 2007)↩
Sartre aurait pu analyser son propre cas, beaucoup plus passionnant que celui de Guillaume II. Dans Les Mots il raconte sa tragédie d’enfance, lorsqu’une maladie oculaire le rendit borgne de l’œil droit, anéantissant sa beauté d’enfant, admirée par tous ses proches. De plus, comme conséquence de sa maladie, il louchait disgracieusement. Cette infirmité explique, au moins en partie, la richesse picturale extraordinaire de ses descriptions de la lumière dans La Nausée (surtout au début du livre) et, peut-être, aussi le « narcissisme métaphysique » qui le poussera à parler avec éclat de son « orgueil absolu » d’être conscient de son être.↩
Il est très instructif, très « pédagogique », de comparer le Journal de Guerre de Simone de Beauvoir avec celui de Sartre, textes écrits en même temps, le premier à Paris, le deuxième en Alsace.↩
Faire la critique du roman et du romancier (et donc, nécessairement, des mécanismes de l’édition dans notre société « romanesque ») aurait obligé Sartre à faire la critique de lui-même en tant que romancier et, qui plus est, en tant que « romancier de Monsieur Gaston Gallimard », qui se vantait pendant l’Occupation nazie de posséder « une maison d’édition aryenne, aux capitaux aryens ». La marge de manœuvre de Sartre était plutôt réduite…↩
Mission qui rappelle, évidemment, celle de Pierre Menard, auteur du Quichotte, le personnage de Borgès.↩
Gac, Roberto, in Sens public.↩