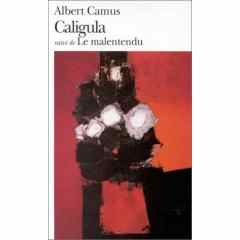« CALIGULA
Je sais que rien ne dure ! savoir cela ! Nous sommes deux ou trois dans l'histoire à en avoir fait vraiment l'expérience, accompli ce bonheur dément ».
Caligula, IV, 13.
« LE VIEUX PATRICIEN
Cela ne te ferait rien de ne pas faire de philosophie ? Je l'ai en horreur ».
Caligula, IV, 4.
« CALIGULA
J'ai vingt-neuf ans1. C'est peu. Mais à cette heure où ma vie m'apparaît cependant si longue, si chargée de dépouilles, si accomplie, enfin... ».
Caligula, IV, 13.
« - Leonard, if Hartmann catches us here, we are both in a world of shit.
- I am in a world of shit ».
Private Leonard « Gomer Pyle », Full Metal Jacket (Stanley Kubrick).
Le théâtre d’Albert Camus a la tenace réputation d’être injouable. Charles Berling, dans une production récente, a fait mentir ce préjugé en offrant au public de l’Athénée, à Paris, en 2006, une représentation de Caligula (1945), pièce dont la narrativité et l’intensité dramatique sont assez riches et soutenues pour tenir en haleine un public dont la critique, compatissante, craint à chaque fois qu’il ne soit égaré ou lassé par la dimension philosophique ou métaphysique de la pièce. Le public a plébiscité le travail de Berling, alors que le propos de l’écrivain est, dans Caligula, explicitement métaphysique : Camus explique en 1941 avoir voulu explorer et étudier les dimensions de l’absurde dans un triptyque composé de L’étranger, de Caligula et du Mythe de Sisyphe, œuvres qu’il nomme ses « trois Absurdes », déclinés par genre : un traité philosophique, un roman, une pièce de théâtre.
L’histoire de Caligula, empereur romain de 37 à 41 de notre ère, nous est connue par des contemporains mécontents (comme Philon et Sénèque) et par Suétone, historien tardif et stipendié par Trajan et Hadrien, deux empereurs qui accueillaient avec bienveillance toute peinture péjorative des julio-claudiens. Par opposition aux optimi principes, Caligula apparaît chez Suétone comme l’archétype du mauvais César, identifié par des stigmates moraux récurrents et stéréotypés, qui se retrouvent dans les Vitae de Néron ou de Domitien : le mauvais empereur est incestueux, avide, mégalomane, impie, cruel, sanguinaire, ivrogne, lascif... Les historiens ont appris à réévaluer les sources et à ne pas acquiescer à la légende noire des Vitae suétoniennes, ce qui a conduit Daniel Nony, par exemple, ou Lucien Jerphagnon à tenter de donner sens à un comportement qui, à première vue, sembler appeler la damnatio memoriae.
Camus, lui aussi, propose, en philosophe, sa propre lecture du règne de Caligula : quel sens assigner au déchaînement d’ironie et de violence d’un jeune homme aussi prometteur et attendu que Caligula, fils de Germanicus, et successeur d’un Tibère si ombrageux, atrabilaire et détesté que les Romains saluèrent sa mort par ce jeu de mots peu amène : Tiberius ad Tiberim ? Camus refuse de suivre Suétone et son heuristique du vice moral ou de la folie et propose une tout autre interprétation du comportement du jeune César. L’intrigue, pourtant, est fidèle à la tradition suétonienne : on voit chez Camus un Caligula criminel, qui tue pour spolier et accaparer (avidité), pour rire et se réjouir (cruauté), qui viole et humilie (lascivité), qui blasphème les dieux en une mascarade burlesque et impie, avant de connaître le juste châtiment des tyrans, par le poignard des conjurés.
Quelques scènes, cependant, donnent à voir un empereur méditatif et mélancolique, doux et réfléchi, qui poétise avec Scipion le Jeune (acte II, scène 14) et philosophe avec Chéréa (acte III, scène 6), installant ainsi l’ambivalence là où le Caligula traditionnel était unidimensionnel. En outre, Camus confère à Caligula une profondeur biographique en l’inscrivant dans la diachronie d’une mutation, d’une évolution personnelle, ce que ne fait pas Suétone, qui décrit Caïus comme ayant été toujours déjà perclus de vices délétères. Plusieurs voix rappellent au cours de la pièce que Caligula n’a pas toujours été ainsi, comme sa maîtresse Caesonia, ou le jeune Scipion :
« Je l’aime. Il était bon pour moi. Il m’encourageait et je sais par cœur certaines de ses paroles. Il me disait que la vie n’est pas facile, mais qu’il y avait la religion, l’art, l’amour qu’on nous porte (…). Il voulait être un homme juste ».
(I, 7)
Est ainsi esquissée la silhouette délicate, fragile et aimable d’un jeune homme habité de bonté et de générosité, affecté d’une certaine difficulté à être, d’une propension à la mélancolie qu’il tente de sublimer par des catalyseurs de sens (religion, art, amour) et par la méditation puisque Chéréa, sans moquerie, rappelle que « ce garçon aimait trop la littérature » (I,6) et que pour son fidèle compagnon, Hélicon, « Caïus a toujours été un idéaliste, tout le monde le sait » (I,2). Caïus Caligula est donc doté par le dramaturge Camus d’une complexité qui crée un fort potentiel d’identification que le monstre de Suétone n’autorise pas. Caligula nous est d’autant plus proche qu’il offre un rassérénant contraste avec les patriciens pragmatiques de la première scène, animaux de cour, esprits bruts et mesquins qui ne connaissent que les dures réalités de l’Etat, les entourloupes, machinations et manigances de la politique courtisane et les jouissances grossières d’une vie médiocre. Caïus a une histoire, une profondeur qui le rendent humain et qui révèlent cette bonté méditative et inquiète que le spectateur accueille et assume dans le procès de la catharsis. Madame Bovary, c’est moi.
Cette mise en perspective vient donc brouiller l’image univoque d’une bête malsaine vouée de toute éternité à la déraison du crime. Caligula n’est pas d’essence criminelle, même s’il en a adopté l’existence. Pour que l’homme qu’il était ait fait un tel choix et soit devenu l’empereur insensible et cruel que nous connaissons et voyons, il faut qu’il y ait eu rupture, une catastrophe fondatrice, inaugurale, que le théâtre met en scène. C’est sur cette catastrophe que s’ouvre la pièce, qui débute par ces deux mots : « Toujours rien », le mot « rien » revenant six fois dans les cinq premières et courtes répliques et révélant ce nihil, ce néant d’une double disparition et d’une prise de conscience. Caligula a disparu, on le cherche, et cette quête est vaine. L’Etat a perdu son chef et quand son chef réapparaît, il semble bien lui-même avoir perdu la tête : hagard, incohérent, presque halluciné, Caïus reparaît souillé et égaré après trois jours d’errance. Trois jours, c’est, au début de chaque cycle lunaire, le temps de la mort, de la disparition du satellite céleste, avant qu’il ne retrouve une croissance. Dans la troisième scène de l’acte I, au moment de son retour au palais, Caligula confie à Hélicon qu’il a erré parce qu’il « voulai[t] la lune » (I, 4). La lune est l’astre de la nuit, du penseur, du méditatif, l’astre qui commande, chez Hegel, l’envol de l’oiseau philosophique. Elle est également l’astre de la féminité et du temps, par ses cycles réguliers qui évoquent ceux de la femme et qui permettent l’élaboration d’un calendrier. Astre féminin, chronique et calendaire, la lune métaphorise le cycle de la vie, de la mort, génération et corruption couronnées d’une résurrection espérée : elle disparaît, puis croît jusqu’à l’acmé de la pleine lune, avant de décroître à nouveau et de retourner au néant.
Or Caligula vient de vivre une expérience où toutes les symboliques lunaires ont partie liée, notamment la féminité et la mort : il vient de perdre sa sœur Drusilla, sœur et épouse à la fois d’un empereur qui, comme Pharaon, est philadelphe.
Le début de la pièce est donc d’une immédiate humanité, accessible à la compréhension commune : Caligula éprouve la douleur folle, insupportable, de la perte, qui l’égare et l’aliène. Après l’errance et la boue, il tient des propos qui touchent à la folie, mais dont l’ironie n’échappe pas : Caligula demande la lune, et sait fort bien qu’il requiert l’impossible.
Les patriciens espéraient que Caligula guérirait de sa douleur par le travail du deuil : « Une de perdue, dix de retrouvées » (I, 1), lâche le vieux patricien, jamais en peine de maximes. Mais Caligula est moins affecté par la mort de Drusilla que par ce qu’elle révèle, par ce qu’elle signifie, un ultime signe dans la débâcle générale du sens et la faillite de toute signification, happée par le néant : « Cette mort n’est rien, je te le jure ; elle est seulement le signe d’une vérité qui me rend la lune nécessaire » (I,4). Cette vérité est dite avec les mots simples et la syntaxe élémentaire, presque naïve, enfantine, du mélancolique qui, après l’aphasie du choc traumatique, revient peu à peu, en grand blessé, précautionneux, perplexe et dubitatif, à l’usage de la langue. On constate souvent chez les grands brûlés du sens, ceux qui sont allés au-delà des mots, ceux qui ont aperçu le néant, cette aphasie perceptive et expressive, et ce retour lent, désenchanté, à une expression faible, hésitante, minimaliste, comme si parler, au fond, ne voulait plus rien dire ou comme si l’ampleur et l’intensité de la prise de conscience excédaient toute verbalisation : « Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable » et « les hommes meurent et ils ne sont pas heureux » (I,4) sont des propositions qui frappent par leur dépouillement, leur sobriété, leur naïveté. Propos simples, petites phrases : inutile d’en faire de grandes quand l’énormité, l’exorbitance de ce qui a été vu, perçu, compris rend dérisoire sa traduction en mots. Avec la mort de sa sœur, Caligula a fait l’expérience de la finitude, il a pris conscience de l’essentielle mortalité de l’homme, promis, comme tout ce qui est, au néant. La lune, dès lors, est la métaphore d’un impossible affranchissement et d’une quête vouée à l’échec : « J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui soit dément, peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde » (I,4). La lune est le chiffre de ces deux termes équivalents, « bonheur » et « immortalité » : le bonheur est impossible si tout ce qui est est voué au néant de la mort et que l’on doit vivre accablé par la conscience de cette finitude.
Si l’usage n’en était pas à tel point galvaudé, usé, et imprécis, on parlerait volontiers ici de « crise existentielle » pour désigner l’accession de Caligula à « une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter » : on va tous mourir, tout est promis au passage, à la corruption, à la fin. Nous passons nos vies à nier cette vérité, à la fuir et à l’esquiver par tous les moyens et voies imaginables, celles du divertissement (Pascal), de l’inauthenticité (bavardage, curiosité et équivoque heideggeriens), des spiritualités de tout crin, des psychotropes ou autres drogues et anxiolytiques. Il est des instants, cependant, où cette vérité luit de son soleil noir, où une lucidité mélancolique fait jour au tragique de l’humaine condition : ces moments ont pour nom démon de midi, acédie, choc post-traumatique, dépression, spleen, mélancolie, crise existentielle. L’humanité commune, représentée dans la pièce par le groupe, anonyme et quasi-indifférencié des patriciens, vulgum pecus, humain trop humain, grégaire, lâche et mesquin, réagit par le déni et le retour aux stratégies d’évitement et d’escamotage évoquées plus haut, alors que certains, comme Caligula, en conçoivent ce type particulier d’éthos que Camus nomme « révolte métaphysique ».
Il est frappant de voir à quel point l’humanité commune, dans la pièce de Camus, est en fuite. Le vieux patricien, par exemple, ne parle le plus souvent que par proverbes et maximes : ce personnage offre un florilège de sentences assénées avec la nonchalance de l’indifférent ou la bonhomie tranquille de l’imbécile, du butor muré dans l’impénitente idiotie d’une radicale absence de pensée : « Une de perdue, dix de retrouvées », « la nature fait bien les choses », « il ne faut pas lâcher la proie pour l’ombre » (I, 1). Pour parler en termes heideggeriens, le vieux patricien est l’incarnation du « On », de ce « je » déchu, tombé dans l’aliénation et l’impropriété, dont le discours est devenu, faute de pensée, simple bavardage, expression de la radicale absence de pensée, de la fuite hors de toute méditation pensante et poétique au profit du calcul (celui des intrigues de cour) et de l’insignifiance. Le Dasein inauthentique, impropre, est devenu simple passeur de sons, à défaut de sens, simple feuille morte flottant dans l’air du temps. Le bavardage est pure communication, pure parole réduite à sa seule fonction phatique, et demeure dans l’ignorance de ce dont on parle au profit du seul parler, du seul bruit divertissant d’une illusoire communauté de sens. Le Dasein inauthentique, celui du bavardage, est le Dasein du refus de la pensée. C’est ce même vieux patricien qui réplique vertement à un Chéréa qui tente d’éclairer le sens du comportement de Caligula : « Cela ne te ferait rien de ne pas faire de philosophie? Je l’ai en horreur » (IV, 4). Sujet déchu, tombé de la mienneté dans la quotidienneté, capable seulement de bavardage, le vieux patricien, homme de la fuite et du déni, ne peut ou ne veut pas penser : il dira « on meurt, certes », mais ne peux dire « je meurs » comme Caligula. On le comprend du reste : qui peut sérieusement et durablement envisager la fugacité des instants, prendre acte de l’impermanence des êtres et des choses, soutenir cette intuition que tout meurt, envisager avec constance la possibilité de la non-possibilité ?
La pensée, qui est pensée de la mort 2 , s’impose à Caligula. Après la mort de sa sœur, il refuse de sombrer dans l’alternative d’une neurasthénie pérenne ou de la fuite. Il s’institue pédagogue du genre humain. L’humanité, prisonnière du déni et de la fuite, lui apparaît méprisable. Hélicon parle du « dégoût » de son maître à « vous voir tous les jours » (I,1), et Caligula clame :
« Autour de moi, tout est mensonge, je veux qu’on vive dans la vérité (…). Ils sont privés de la connaissance et il leur manque un professeur qui sache ce dont il parle ».
(I,4)
Caligula, lui, sait, car il a vu le néant de toute chose.
L’enseignement de Caligula se veut une pédagogie de l’acte pour faire accéder une humanité vagissante à cette vérité : tout est promis à une fin certaine, tout se vaut, tout est indifférent. Le projet pédagogique de Caligula, professeur de lucidité, s’accompagne d’un solide mépris du maître pour ses élèves. Le « dégoût » évoqué par Hélicon témoigne d’une profonde lassitude de l’empereur qui, entouré de flatteurs, d’opportunistes, d’ambitieux, de cyniques et de lâches, ne connaît l’humanité que par les courtisans et les fâcheux. L’image de l’homme que lui renvoie son entourage est déplorable. Le vieux patricien vient ainsi dénoncer ses amis qui, avec lui, complotent contre la vie de Caligula. Sans cesse humilié et dégradé par l’empereur, qui le surnomme « ma jolie » depuis trois ans, le vieux patricien, tel un chien, « gratte à la porte » de Caligula, puis « se tortille » comme un ver en protestant de son amour et de son dévouement. Dans cette scène (III,4), Caligula démontre au patricien que ce qu’il dénonce n’est pas, avant de congédier le délateur avec une ironie désespérée :
« Alors, disparais, ma jolie. Un homme d’honneur est un animal si rare en ce monde que je ne pourrais pas en supporter la vue trop longtemps. Il faut que je reste seul pour savourer ce grand moment ».
(III,4)
Cette solitude et ce mépris de l’homme, deux attributs du mélancolique, sont aggravés par la fuite de(s) dieu(x). Caligula a induit de son expérience (la perte de Drusilla) une conscience de la finitude qui inaugure une appréhension nihiliste de l’existence et du monde. La mort est ce néant qui néantise tout étant. Rien n’est de manière durable ou ferme. Caligula est donc une pièce sur le nihilisme : elle est, nous l’avons vu, ouverte par le mot « rien » (nihil). Le nihilisme tel qu’il est mis en scène et explicité par le comportement et le discours de Caligula repose sur la conscience angoissée de la finitude, couplée à une déréliction, un délaissement, qui prend acte de la mort de(s) dieu(x).
Caligula vit la déréliction de l’homme qui a conscience d’être jeté dans le monde sans caution ni garantie du sens et de la valeur : « Du ciel ! Il n’y a pas de ciel, pauvre femme » (IV, 13). On ignore si Caligula croyait aux dieux avant la mort de Drusilla et la crise subséquente. Si c’est le cas, cette foi hypothétique n’a pas survécu. Le jeune homme montre en quelle pieuse estime il tient des dieux incapables de prévenir le scandale de la mort, qu’il ridiculise dans une mascarade carnavalesque, une saturnale blasphématoire qui se joue des locataires supposés d’un Olympe imaginaire, divinités inexistantes dont l’impuissance est bien assez révélée par le seul fait de la mort. Caligula se grime en Vénus de lupanar, contrefaisant la déesse et obligeant les sénateurs et patriciens à verser le denier du culte. Il rejoint le Caligula historique, qui revêtait les atours de Vénus, de Jupiter et de Mercure, non par folie ou dérision, mais pour signifier et incarner la polydivinité d’un empereur-pharaon qui représentait dans le monde des hommes la totalité du Panthéon. Homologue du roi des dieux, il avait toute licence à en adopter les traits et les visages et le faisait en toute bonne foi car le Caesar du Ier siècle n’avait lu ni Zarathoustra, ni Le gai savoir.
Dans cette scène, comme dans la fébrile activité meurtrière de Caligula, l’angoisse née de la double conscience du vide céleste et de la finitude, prend l’aspect d’une révolte rageuse, révolte de l’individu jeté dans le monde pour y mourir, de l’innocent condamné à mort. Dans ses Mémoires d’une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir rapporte en ces termes la perte de sa foi :
« Je ressentis dans l’angoisse le vide du ciel (…). Quel silence ! (…) Je réalisai que j’étais condamnée à mort (…). Plus que la mort elle-même, je redoutais cette épouvante qui bientôt serait mon lot, et pour toujours 3 ».
C’est dans des termes identiques que Camus, opposant notoire à la peine capitale, décrit l’atroce délaissement de l’homme qui va mourir dans la solitude de l’abandon, la double solitude de la fuite des dieux, du sens et de la valeur et celle de celui qui, ayant vu mourir autrui, meurt seul. « Je » meurt toujours seul, toute communauté humaine, celle de l’amour, de l’amitié ou de l’intérêt, bientôt dissoute par la mort, étant illusoire. Tant de solitude, de conscience de la finitude et de sentiment d’injustice suscitent la révolte. Dans L’homme révolté, Camus explique que « le révolté métaphysique », dont Caligula est un représentant, est en révolte « contre la condition qui lui est faite en tant qu’homme 4 », qu’il profère « une accusation enragée de cette condition régie par la peine de mort généralisée 5 ». Le délaissement qui caractérise cette confrontation entre l’homme et la mort, en l’absence de tout Dieu qui pourrait nourrir l’Espérance de la Foi, deux des trois vertus théologales, rend presque tangible la définition que Camus, dans Le mythe de Sisyphe, donne au sentiment de l’absurde, cette rencontre entre l’appel de l’homme et le silence déraisonnable du monde.
La vanité ontologique de toute chose, en l’absence de(s) dieu(x), ne peut plus être, comme dans le christianisme médiéval et renaissant, un simple exercice spirituel, l’élément d’une pédagogie du salut. Le motif de la Vanitas ou du Memento mori était une exhortation positive à l’humilité chrétienne et à une Meditatio mortis qui conduit à la prière et à la repentance. Désormais, la conscience de la finitude n’est plus liée ni à la Foi, ni à l’Espérance. « Vanités des vanités » n’est plus la maxime de l’âme qui, sublime, se détourne du terrestre pour embrasser le céleste : le vide du ciel laisse l’homme à l’abandon d’une solitude qui n’a plus d’autre horizon que la corruption et la mort, sans plus aucun espoir d’un quelconque arrière-monde salvateur.
De cette vanité ontologique, le nihilisme tel qu’illustré par Caligula induit une nullité axiologique. Si tout est promis à la fin, et si nulle instance transcendante n’est pour édicter et garantir des valeurs, tout est indifférent, tout est réduit à une absolue équivalence, à une stricte égalité. Dans la pièce est en effet présent un autre thème à consonance chrétienne, celui du Mors aequat omnia, devise illustrant ces danses macabres, où l’on voit la mort emmener dans une dernière gigue gueux, évêques, chevaliers et princes. Là encore, le Mors aequat omnia n’appelle plus l’homme à l’humble méditation de sa finitude, mais revêt une signification et une valence proprement dévastatrices : « Ce monde est sans importance » (I,10) aux yeux de Caligula, car il est tout entier gangrené, nécrosé, corrodé d’une essentielle finitude. Cette sentence, qui pourrait évoquer le « Mon royaume n’est pas de ce monde » du Christ, n’ouvre, là encore, sur aucun horizon sotériologique ou eschatologique. La transcendance n’est plus, les « arrière-mondes » (Nietzsche) ou le « suprasensible » (Heidegger) ne fondent ni ne garantissent plus l’être, ni la valeur de l’étant. Caligula vit le radical abandon de celui qui se sait pure facticité et pure contingence, pur fait non affecté d’un sens, d’une nécessité ou d’une valeur par un dieu prévoyant, provident et bon. La mort de(s) dieu(x) annoncée (et dénoncée) par Nietzsche signe la mort du sens évident : l’absence de(s) dieu(x) est une absence de sens, c’est-à-dire de cette direction qu’était le salut et de cette herméneutique universelle que proposait le projet providentiel. L’être au monde, Caligula en prend conscience, est un être jeté dans la solitude du délaissement, dans l’absence de projet proposé ou imposé par la transcendance d’une divinité qui édicterait normes et valeurs et dicterait le sens.
En l’absence de(s) dieu(x), la vanité ontologique aboutit à l’absurde étudié dans le Mythe de Sisyphe et à la nullité axiologique du nihilisme. Mors aequat omnia : la mort rend tout égal, donc elle rend tout radicalement indifférent, d’une équivalence qui est, au fond, absence de valence. Caligula se heurte à sa maîtresse Caesonia, effrayée du changement dans l’attitude de son amant. Contre lui, contre la violence de son désespoir, Caesonia réaffirme un monde normé, structuré par des valeurs éternelles, par une axiologie du juste et de l’injuste, homologue à l’orientation de l’espace, définie par les directions du haut et du bas. Son bon sens défend que, aussi vrai qu’il y a quatre directions, aussi vrai il y a des valeurs qui orientent l’homme :
« Il y a le bon et le mauvais, ce qui est grand et ce qui est bas, le juste et l’injuste. Je te jure que tout cela ne changera pas ».
(I, 11)
La tirade de Caesonia, sa réaffirmation des valeurs, évoque, en négatif, le champ de marche et de combat des Waffen-SS, le « Chant du Diable » :
« Wir pfeifen auf unten und oben / Und uns kann die ganze Welt / Verfluchen oder auch loben / Ganz wie es ihr wohl gefällt » (« Nous nous moquons du haut et du bas / Et le monde entier peut bien / Nous maudire ou nous louer / Tout comme il lui plaira »).
Cette strophe est une négation axiologique du plus pur style, adornée d’une profession d’indifférence absolue aux réactions provoquées, à la louange ou à la malédiction, à l’amour ou à la haine. Quand Chéréa dit vouloir « lutter contre une grande idée dont la victoire signifierait la fin du monde » (II,2), il entend certes le nihilisme, mais il n’est pas interdit de penser que Camus en identifiait une manifestation contemporaine dans le national-socialisme, dont les bruits de botte scandent la rédaction de Caligula, entamée en 1938 6 .
Pour Caligula, malgré les efforts de Caesonia, il n’y pas de haut, pas de dieu(x). En pédagogue soucieux de tirer toutes les conséquences de ce fait, il promet : « Je ferai à ce siècle le don de l’égalité » (I, 11), en montrant aux hommes que leurs vies, leurs normes, leurs biens et leur monde ne sont rien, ni rien de signifiant, face à une mort qui les engloutit dans le gouffre béant du néant. Devant le spectacle de sénateurs humiliés et contraints de se renier, Caligula s’amuse : « Rien ne va plus. Honnêteté, respectabilité, qu’en dira-t-on, sagesse des nations, rien ne veut plus rien dire » (II, 5).
Ce thème de la nullité des valeurs, déduite de la vanité des êtres et des choses, est réitéré au cours de la mascarade burlesque au cours de laquelle Caligula, grimé en Vénus, humilie ces dieux qui ne sont pas. Les sénateurs et patriciens de la cour sont forcés, nous l’avons vu, de communier dans le culte de la déesse en lui adressant une prière qui demande entre autres à la déesse :
« Enseigne-nous l’indifférence (…), instruis-nous de la vérité de ce monde qui est de n’en point avoir (…) et accorde-nous la force de vivre à la hauteur de cette vérité sans égale ».
(III, 1)
Là encore, qui peut durablement vivre à cette hauteur sans devenir fou ou choisir de déchoir à nouveau dans l’affairement du divertissement ? L’air des cimes et des glaciers prend ici trop la fraîcheur humide des haleines de sépulcre.
Pour annoncer la scène du blasphème, Hélicon annonce en Caligula-Vénus « le destin lui-même dans sa marche triomphale ». Caligula a en effet décidé de se faire destin pour être le pédagogue de la lucidité et le professeur du nihilisme. L’expérience de la mort de Drusilla a appris à Caligula que le seul sens décelable dans l’absurdité du monde était le caprice aléatoire d’une mort qui frappe à l’aveugle, sans norme ni ordre, un pur et incompréhensible hasard que des humains en quête désespérée de crédulité ont nommé Destin et dont ils ont fait des dieux. Caligula veut montrer l’inanité de ce dernier écran de fumée opposé à la conscience de l’absurde et qui a nom divinité. Les hommes esquivent leur essentiel délaissement en imaginant que des dieux, quelque part, vraisemblablement, sans doute, disposent des êtres et des choses selon leur volonté et que donc ce qui advient est affecté d’une signification. En endossant le rôle du destin, en agissant comme agissent ces dieux imaginaires, Caligula se fait professeur d’absurde à l’usage de ces enfants d’humains : « Je me suis fait destin. J’ai pris le visage bête et incompréhensible des dieux » (III, 2).
Revêtant les atours du Destin, Caligula en adopte les facultés, notamment celle de susciter des catastrophes. Il annonce ainsi à l’Intendant sa volonté, arrêtée par décret, de fermer les greniers de l’Etat pour provoquer une famine. Devant la protestation de l’Argentier, interdit, Caligula s’exclame : « Je dis qu’il y aura famine demain. Tout le monde connaît la famine, c’est un fléau. Demain, il y aura fléau... et j’arrêterai le fléau quand il me plaira » (II, 9).
Le Destin, cette chimère élaborée par une intelligence humaine qui étanche sa soif herméneutique à coups de Panthéons et de Providences, cette hypostase fantasmatique qui vient apaiser une fébrile quête de signification, est donc avant tout dispensateur de malheurs, cette expérience sensible de notre finitude, marquée au sceau de la vulnérabilité. Le Destin, qui n’existe pas, est un assassin à l’assiduité négligente, au caprice impérieux, qui frappe et tue selon un bon plaisir à tel point incohérent qu’il ne peut être que hasard. Caligula va donc lui-même frapper de mort arbitrairement. Il va tuer les riches patriciens, dans un ordre indifférent. Si Drusilla, sœur et amante dans la fleur de l’âge, a été engloutie par le néant, tout le monde, jeune ou vieux, riche ou pauvre, est appelé à mourir sur le champ, ou plus tard, peu importe : tout n’est qu’ arbitraire et hasard, aléa cruel qui régit notre condition. Dans la scène 10 de l’acte II, Caligula assassine le patricien Mereia en lui brisant une fiole de poison à coups de poing sur le visage. Il accusait Mereia d’avoir absorbé, au préalable, un antidote, alors qu’il ne s’agissait que d’un remède contre l’asthme. Quand Caesonia le confirme, Caligula, en « s’essuyant les mains », un geste qui rappelle l’équanime indifférence de Ponce Pilate, lâche : « Cela ne fait rien, cela revient au même. Un peu plus tôt, un peu plus tard... », Mereia était, de toute manière, promis à l’absurde de la mort, ce n’était qu’une question de temps.
En incarnant de manière immédiate et sensible ce Destin ou ce(s) dieu(x) que les hommes fantasment dans leur déréliction, pour tenter de trouver du sens là où il n’y en a pas, Caligula entend tirer les hommes de leur sommeil métaphysique et susciter chez eux une réaction qui soit plus digne que cette fuite dans l’inauthentique qui constitue leur existence. Il est dit à plusieurs reprises dans la pièce que Caligula, comme le dit Hélicon, « ne verrait pas d’un mauvais œil » (II, 13) que l’on se révoltât contre lui et qu’on le tuât. Plusieurs fois informé d’un complot pour attenter à sa vie, il congédie Hélicon l’informateur (III, 3), puis le vieux patricien délateur (III, 4), avant de brûler les documents accusatoires qui l’accablent devant Chéréa lui-même (III, 6). Il faut y voir l’aspiration à la mort, la pulsion suicidaire du mélancolique saisi par le pessimisme, qui souffre de vivre le monde comme un cauchemar 7 , dans l’absurde de la déréliction, qui souffre dans son âme et son corps de cette privation de sens :
« Oh ! Caesonia, je savais qu’on pouvait être désespéré, mais j’ignorais ce que ce mot voulait dire. Je croyais comme tout le monde que c’était une maladie de l’âme. Mais non, c’est le corps qui souffre ».
(I, 11)
Caligula, qui, dans la pièce, souffre d’insomnies, est affecté de douleurs stomacales. Il vit une révolte du corps qui se cabre et réagit avec violence à cette extinction qui lui est promise. Avec toute la force de son impuissant vouloir-vivre, le corps réagit par la nausée, le rejet, le vomissement d’une rébellion désespérée. Se départir de la vie est dès lors le seul remède. Caligula, au fil de la pièce, évolue du meurtre au suicide qui est, nous y reviendrons, affirmation d’un sens et position d’une valeur, en dépit de tout.
On peut de fait voir, dans cet appel de révolte, la volonté pédagogique d’un Caligula soucieux d’amender l’humanité malgré elle en la poussant à la révolte, donc à la pensée. Au sein d’une humanité opprimée, humiliée par un empereur aussi cruel que le destin, Caligula veut faire lever une révolte contre lui-même qui soit en même temps indignation profonde et réfléchie contre ce destin dont il a adopté le masque et le déportement. La révolte contre Caligula aurait une signification métaphysique car elle serait révolte contre ce destin aveugle qui frappe de mort et détruit tout, mais également, et plus profondément, contre une condition humaine absurde sur laquelle on effectuerait enfin un retour de pensée. Ce que Caligula ambitionne, Chéréa le perçoit :
« Reconnaissons au moins que cet homme exerce une indéniable influence. Il force à penser. Il force tout le monde à penser. L’insécurité, voilà ce qui fait penser. Et c’est pourquoi tant de haines le poursuivent ».
(IV, 4)
Intéressante mise en abyme : Caligula-Empereur force les personnages de la pièce à penser, tout comme Caligula pièce de théâtre métaphysique d’Albert Camus, ébranle le spectateur.
Ce n’est qu’ainsi, par la révolte, thème camusien par excellence, que l’homme pourrait recouvrer une dignité, de même que, par la pensée, il pourrait retrouver une authenticité, en s’affranchissant des arrières-mondes fantasmatiques que son appel de sens suscite, et en se libérant de cette pulsion de fuite qui le conduit à se nier comme être de pensée pour mieux escamoter une pensée de la mort qu’il esquive par la fuite.
Révolte et liberté ont donc partie liée. Le thème de la liberté est présent dans la pièce, mais moins à l’état d’affirmation que comme question, moins comme position que comme débat, comme tension entre une liberté négative et son contraire, indéfini, car Caligula se borne à reconnaître qu’il s’est sans doute mépris sur la définition de la liberté. Si rien n’est vraiment, car tout est promis à la corruption et à la néantisation, si rien ne vaut vraiment, alors, selon Caligula, l’homme est libre, affranchi de tout lien terrestre et humain, car tout meurt, et de toute norme, car il n’est personne pour les édicter :
« Ce monde est sans importance et qui le reconnaît conquiert sa liberté. Et justement je vous hais parce que vous n’êtes pas libres. Dans tout l’empire romain, me voici seul libre. Réjouissez-vous, il est enfin venu un empereur pour vous enseigner la liberté ».
(I, X)
Voilà une liberté bien conditionnelle : elle est tout d’abord conçue en termes négatifs (la liberté est absence de tout lien), et elle n’est propre qu’à l’Empereur, qui n’entend pas abdiquer son pouvoir ni permettre à Rome de retourner à la libertas républicaine, pré-augustéenne. Enseigner la liberté ne signifie pas être animé du projet positif et éthique de déconstruction du principat, mais faire prendre conscience, en même temps que du délaissement, du déliement.
La liberté de Caligula, c’est le radical affranchissement de l’être délié et délaissé de la conscience absurde. La mort de Drusilla a provoqué chez le jeune homme la conscience que tout sens a été évacué du monde : la mort de Dieu (Nietzsche) ou la fuite hölderlinienne des dieux (Heidegger) prive l’homme de toute direction (celle du salut) et de toute signification (autrefois assignée par la providence). Dans un monde privé de sens, il n’y a plus, pour Caligula, que deux sortes d’individus : ceux qui trompent la mort par le divertissement, ou qui sont d’une intelligence trop brute pour accéder à la conscience de la finitude, et ceux qui, comme lui, ont vu le néant, sont allés au-delà de l’imposture du langage, des masques du theatrum mundi, des mots dont on se berce, des récits dont on se conforte, des hypostases dont on se rassure. La liberté de Caligula est la liberté désespérée de l’être absurde qui vit dans un cauchemar, celui de la fuite du temps et du triomphe de la mort : rien n’est vraiment, car tout meurt, rien ne vaut, donc je suis libre.
La liberté de Caligula, loin d’être conçue et vécue dans les termes positifs de l’affranchissement et de l’épanouissement du sujet jusnaturaliste, est donc angoisse. En ce sens, Camus entre en résonance avec ses contemporains existentialistes athées, notamment Heidegger. L’être-jeté au monde du Dasein est, chez Heidegger, privation d’origine et de destination. Le Dasein est un hasard placé entre deux béances, celles de la provenance et celle de la direction. L’être-jeté du Dasein est donc une pure ouverture, une pure potentialité qui n’est assignée à aucune fin. Par son essentielle indétermination, l’être-là est liberté et responsabilité : liberté du choix et responsabilité de sa décision. Son indétermination conduit le Dasein à déterminer lui-même, par sa décision, son existence. La décision de Caligula est une décision de dégoût, de nausée et de révolte face à la privation de sens dont la mort de Drusilla lui révèle l’angoissante et désespérante vérité. La plupart des hommes préfèrent oublier cette liberté et cette responsabilité dans la déchéance de la quotidienneté, du On, comme les patriciens. Caligula crie au visage des hommes et du monde que, face à la mort qui néantise, et en l’absence de détermination, il n’est rien qui vaille ni qui soit.
Faute d’instance édictrice et garante du sens et de la valeur, tout n’est que pure convention, et c’est ce que Caligula se propose d’enseigner aux hommes : il suffit d’adopter un postulat, et d’en déduire les conséquences que le raisonnement en fait découler. Car, en effet, devant ce constat désenchanté et angoissant de l’absurde, du vide et du silence du monde, les postulats sont indifférents. Dès lors, que reste-t-il sinon la logique ? Dans cette fuite des dieux et ce flux des êtres et des choses emportés vers l’abyme du néant, demeure une chose, telle qu’en elle-même, inchangée, pérenne, car, au fond, affectée de cette indétermination qui inaugure l’absurde : la raison et son implacable concaténation déductrice des causes et des conséquences.
De retour après trois jours de disparition, Caligula est assailli par l’Intendant qui lui soumet des questions de finances publiques, ce qui suscite, précise la didascalie, « son rire inextinguible » : « Le Trésor, mais c’est vrai, voyons, le Trésor, c’est capital » (I, 7). Ce jeu de mot inaugure le grand jeu de Caligula, un jeu qui doit éduquer ces enfants de patriciens et de sénateurs à la conscience du néant, et durant lequel Caligula va se jouer des conventions et des normes, des mots et des hommes, qu’il méprise souverainement pour leur médiocrité, leur ignorance et leur lâcheté, et qu’il accable d’une salve de calembours. Il oppose ainsi à Caesonia que « le Trésor est d’un intérêt puissant » et que, face au néant, à l’inéluctabilité de la mort, « tout est sur le même pied : la grandeur de Rome et tes crises d’arthritisme ».
Le postulat est choisi : le nouvel ordre des valeurs sera fondé sur une valeur suprême arbitrairement choisie, celle du Trésor, sur l’obligation des obligations, sur l’obligation, avant toute chose, de faire rentrer des deniers dans les caisses de l’Etat. Dès lors que cette valeur est posée, comme le pourrait être toute autre de manière purement équivalente, il faut agir en conséquence : les fortunés de l’Empire devront rédiger « sur l’heure » un testament « en faveur de l’Etat ». L’Etat, par la suite, fera « mourir ces personnages, dans l’ordre d’une liste établie arbitrairement (…). L’ordre des exécutions n’a, en effet, aucune importance. Ou plutôt, ces exécutions ont une importance égale, ce qui entraîne qu’elles n’en ont point » (I, 8). Caligula formule donc une hypermorale purement formelle, par delà bien et mal, puisque l’axiologie traditionnelle a été anéantie par la mort de(s) dieu(x). Un postulat, des conséquences, le pur formalisme de la déduction. L’absurde inaugure et consacre donc la domination incontestée de la seule logique, ce que Caligula explique en ces termes à l’intendant :
« Ecoute-moi bien, imbécile. Si le Trésor a de l’importance, alors la vie humaine n’en a pas. Cela est clair. Tous ceux qui pensent comme toi doivent admettre ce raisonnement et compter leur vie pour rien puisqu’ils tiennent l’argent pour tout. Au demeurant, moi, j’ai décidé d’être logique et puisque j’ai le pouvoir, vous allez voir ce que la logique va vous coûter ».
(I, 8)
Camus partage et expose donc une conception ancillaire de la raison, cette raison instrumentale sur laquelle, depuis la Première Guerre mondiale et ses désastres, la pensée occidentale opère un retour sévèrement critique. Comme l’écrit Paul Nizan, dans Les chiens de garde :
« L’intelligence (…) sert à tout, elle est bonne à tout, elle est docile à tout (…). Intelligence utile au vrai, au faux, à la paix, à la guerre, à la haine, à l’amour. Elle renforce avec une indifférence d’esclave les objets auxquels tour à tour elle consent à s’asservir, la géométrie et les passions de l’amour, la révolution et la stratégie des états-majors. Cette grande vertu est simplement technique 8 ».
Nizan se fait ici la voix d’une sensibilité critique développée par l’Ecole de Francfort et par Martin Heidegger. Depuis que, en 1919, Paul Valéry a déploré, dans un texte célèbre, « l’impuissance de la connaissance à sauver quoi que ce soit » et que « la science » ait été « atteinte mortellement dans ses ambitions morales, et comme déshonorée par la cruauté de ses applications 9 », la critique d’une raison à laquelle l’on n’avait que trop cru, et qui a déçu les espoirs renaissants, aufklärerisch, puis positivistes d’un progrès indéfini, a marqué les années 20 et 30 du vingtième siècle. Dès avant l’extermination industrielle de la Shoah et les applications militaires de la science atomique, Heidegger prévient l’occident des conséquences qu’implique la domination, depuis Descartes, d’une pensée réduite au simple calcul machinalisant de l’étant. L’oubli de l’être et le calcul consommant et consumant de l’étant trouve son acmé dans la modernité scientifique et technique qui menace la terre, séjour de l’homme, de dévastation : la pensée (logos) déchue en raison (ratio), comprise comme pur calcul, n’est que l’instrument neutre et servile d’une volonté de puissance qui, depuis la mort de(s) dieu(x), est la seule vie et valeur de cet étant particulier qu’est le Dasein. Theodor Adorno et Max Horkheimer exposent quant à eux la dialectique de la raison, propos que le second développe et explicite dans Eclipse of Reason (1947), dont le titre allemand, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, consacre le concept de « raison instrumentale ».
Le texte de Camus se déploie donc le contexte d’une sévère remise en cause des espoirs positivistes. L’hybris du Prométhée rationnel, celui des Lumières, de l’humanisme, de la machine à vapeur et de la fée électricité, n’est plus de mise. La pédagogie nihiliste de Caligula vise à montrer que, dans l’indétermination de son être-jeté, l’homme ne peut même pas recourir aux voies humaines, trop humaines, de son intelligence pour édifier un sens : la raison sert à tout, elle est bonne à tout. Comme l’homme, elle est aussi radicale indétermination, pure potentialité, totale ouverture, essentielle indéfinition. Elle n’est qu’un moyen de déduire et d’agir avec conséquence, mais sa compétence, qui a trait aux seuls moyens, ne touche pas aux fins, et sa juridiction ne s’étend qu’aux faits, et non aux valeurs. Signe et illustration supplémentaire de son abandon à l’absurde, la raison instrumentale a cette qualité que, comme le vouloir-vivre schopenhauerien ou la volonté de puissance nietzschéenne, et aussi aveuglément qu’eux, elle est peu ou prou la seule réalité humaine qui subsiste face à la néantisation de la mort : elle fonctionne, malgré la mort, malgré tout. La raison instrumentale est substantielle et dure comme les usines, les armes et les chars qu’elle produit. Elle n’est qu’un instrument parfaitement neutre qui fonctionne indifféremment à ces postulats et à ces fins, abandonnés au libre arbitraire des caprices, idéologies, utopies ou fantasmes élaborés par les passagers de la nef des fous. Elle ne les questionne pas, elle les sert, quels qu’ils soient. La raison instrumentale, que Caligula nomme logique, est le seul recours de l’homme jeté dans un monde privé de sens : une fois le postulat choisi, elle déroulera son activité et plongera l’homme dans le divertissement d’un affairement qui le détournera de la pensée de la mort. De signe de son délaissement, la raison devient, aux yeux de l’homme, salut par le calcul, pensée inauthentique, certes, oubli de l’être, sans doute, mais instrument de maîtrise et domination de la nature en même temps que divertissement bienvenu. La raison calculante, la « logique », est ce seul et frêle recours de l’homme qui, privé d’origine et de destination, ne sait sans elle comment se déporter et gouverner. Dans un monologue angoissé, qui rappelle le Christ au jardin de Gethsémané, Caligula, après avoir redouté le calice d’un supplice qui s’annonce, se ressaisit :
« La logique, Caligula, il faut poursuivre la logique. Le pouvoir jusqu’au bout, l’abandon jusqu’au bout. Non, on ne revient pas en arrière, et il faut aller jusqu’à la consommation! ».
(III, 5)
Cette consommation est moins la destruction universelle qui marque le terme du nihilisme meurtrier que le suicide. Contre l’absurde et la logique du crime, Caligula adopte à nouveau une position de sens. Dans L’homme révolté, Camus observe que le nihiliste, figure de la révolte métaphysique, déduit d’un constat du néant soit la licéité absolue du meurtre, soit la nécessité du suicide. Dans le premier cas, le meurtre est fondé sur la mortalité, le nihiliste jugeant, comme Caligula face aux Patriciens, « qu’il est indifférent de tuer ce qui, déjà, est voué à la mort 10 ». Le révolté signifie ainsi qu’il « préfère l’injustice généralisée à une justice mutilée 11 ». Le second terme de l’alternative nihiliste, de cette décision cernée par le néant, est le meurtre de soi, le suicide. Or, dans des pages saisissantes, Camus remarque que « tout suicide solitaire est (…) généreux ou méprisant. Mais on méprise au nom de quelque chose 12 ». Le suicide est donc, quoiqu’on en ait, position de valeur, affirmation d’un sens quelconque, parfois à l’insu même du meurtrier de soi qui pense ainsi, à tort, parachever la logique du néant :
« On croit tout détruire et tout emporter avec soi, mais de cette mort même renaît une valeur qui, peut-être, aurait mérité qu’on vécût. La négation absolue n’est donc pas épuisée par le suicide. Elle ne peut l’être que par la destruction absolue, de soi et des autres 13 ».
Camus avance comme illustration historique contemporaine du nihilisme en acte les suicidés nazis, Hitler au premier chef, car, pour eux, « l’essentiel était de ne pas se détruire seul et d’entraîner tout un monde derrière soi » dans une apothéose macabre qui ne se limitait pas aux menées solitaires de quelques fous tapis dans des « terriers », mais qui ambitionnait bel et bien l’effondrement d’un monde dans une apocalypse généralisée. Le suicidé nazi meurt, comme Magda Goebbels, désespérée par la mort d’une idée, à laquelle rien ni personne ne doit survivre. Le suicidé nazi est avant tout meurtrier.
Le véritable suicidaire meurt au contraire au nom d’une réalité qui eût pu être et qui pourrait être autre, en ne préjugeant pas du devenir de ses frères humains et, surtout, en les laissant libres de vivre et en leur laissant la possibilité de créer du sens.
Dans la pièce, il est manifeste que Caligula évolue d’un pôle du nihilisme à l’autre, du meurtre au suicide. Son acquiescement à la conjuration, sa lassitude et la latitude qu’il laisse aux comploteurs, la liberté qu’il accorde aux poignards de se lever contre lui équivalent à une mort volontaire. Caligula, selon l’analyse de Camus, pose donc une valeur, son suicide est encore, quoiqu’à un degré minimal, espoir de sens. A l’horizon du néant et au crépuscule des dieux est opposé l’aube timide du sens renouvelé créé par la révolte.
Nous avons vu que Caligula appelle et souhaite une révolte contre lui qui fût révolte contre le destin et contre l’humaine condition, celle des condamnés à (la) mort. Par la révolte, l’homme, qui apparaissait dans toute la médiocrité de la peur, du déni et de la fuite, recouvre une dignité. Il ne se laisse plus frapper par le sort et par le pouvoir, mais se dresse dans une opposition qui est en même temps position d’une valeur supérieure propre à justifier, malgré tout, la vie. Cela peut-être illusoire et dérisoire, car la fin demeure la même, mais la pose est élevée et les actes sont sublimes, arrachant un peu l’humanité à cette accablante médiocrité qui désespère Caligula. Cette posture est incarnée par Chéréa, notamment dans la scène 6 de l’acte III qui l’oppose à Caligula : tentons, malgré tout, de vivre et d’être heureux. La logique du crime justifié par l’équivalence de toute chose ne mène, en définitive, qu’à un surcroît de malheur dans le temps imparti. Caligula l’écoute, comme, par ailleurs, il écoute Scipion et Caesonia : critique et réfutateur, il laisse tout de même voix à cette idée.
En outre, la révolte, qui pose une valeur, crée du sens en reconstituant une communauté humaine. Si la dissolution de la mort, cette rupture universelle du néant sépare les êtres comme elle sépare Caligula de Drusilla, rendant ainsi risible et illusoire toute idée, tout fantasme de communauté humaine, la révolte métaphysique brave la fatalité de la séparation par la réparation d’une entr’appartenance commune, certes peu durable, sans doute frappée d’impermanence, mais fondatrice d’une solidarité, intense dans l’acte exaltant qu’elle suscite, et profonde dans ses implications : « Dans la révolte, l’homme se dépasse en autrui et, de ce point de vue, la solidarité humaine est métaphysique 14 ».
L’assassinat-suicide de Caligula, révolte contre le destin et sa personnification impériale, est affirmation de valeur et recréation de la communauté des hommes. Cependant, Caligula appelle la mort parce que, de son point de vue, toutes les tentatives humaines pour créer du sens sont vouées à un échec ultime, à la promesse du néant qu’il ne parvient pas à évacuer de son horizon ou à masquer. Caligula est, aux yeux de l’humanité commune, le type même du fou, du dérangé, de celui que l’on va ordonner à une topographie du décalage (il est à côté) alors que son cheminement relève de deux autres métaphorisations géographiques. Celle de l’ultérieur d’abord : il est allé au-delà, au-delà des mots, des leurres et des masques, et il y a vu le néant. Celle de la profondeur ensuite : il a fendu la surface et a atteint des fonds de lucidité dont il est certes revenu, mais lesté d’un poids de conscience qui lui interdisent désormais tout espoir, toute légèreté. Un temps professeur de lucidité, Caligula, au fil de la pièce, se réduit peu à peu à l’idiosyncrasie d’une souffrance personnelle. Sa prise de conscience de la vanité, son aperception du néant et les conclusions nihilistes qu’il en tire n’ont peut-être pas de valeur universelle, et n’ont de validité que particulière à une sensibilité individuelle. Le soleil noir de la lucidité ne brille pas pour tout le monde : le premier mouvement est de mépriser l’humanité qui ne perçoit ni ne pense sa condition. Le second est de supposer que, peut-être, la déshérence est un sentiment singulier et la révolte nihiliste subséquente n’a rien d’apodictique. Les entretiens avec Scipion et Chéréa, mais aussi le souvenir d’un tendre espoir perdu peuvent suggérer à Caligula la relativité singulière d’une idée à laquelle il conférait l’absoluité du néant. Dès lors, être de déréliction abandonné à la solitude d’une idiosyncrasie spécifique, du quant-à-soi singulier de la passion mélancolique, Caligula renonce à imposer l’universalité de sa vérité par le meurtre universel et n’a d’autre choix, dans sa solitude et sa souffrance, que de mourir.
Outre la révolte, la création de sens est rendue possible par l’amour. Caligula n’y croit pas, ou plus. A Caesonia, plus âgée, qui veut l’amender par l’amour, Caligula oppose que sa beauté en flétrissure est un démenti suffisant, une goujaterie métaphysique qui signifie la vanité de cette communauté de sens, car même les objets de l’amour, et sans doute le lien d’amour lui-même, sont frappés d’impermanence :
« L’amour ne m’est pas suffisant, c’est cela que j’ai compris alors. C’est cela que je comprends aujourd’hui encore en te regardant. Aimer un être, c’est accepter de vieillir avec lui. Je ne suis pas capable de cet amour. Drusilla vieille, c’était bien pire que Drusilla morte » .
(IV, 13)
L’angoisse de la finitude, du passage est impérieuse en Caligula. Dans son propos, Caligula confesse qu’il y a pire que la mort des êtres aimés : la mort de l’amour lui-même. Il reconnaît qu’il n’aurait pas été capable d’aimer Drusilla longtemps, une fois que son corps, marqué par le temps, serait devenu le vivant et morbide témoignage du passage. La nausée du révolté est dégoût devant ce corps qui est épiphanie des signes de la mort en progrès, dégoût devant ce cycle absurde de la croissance et de la corruption, devant l’apparition toujours renouvelée d’une vie en de petits êtres que l’on voit grandir et dont la génération donne la mesure de notre propre dégénérescence. La nausée de Roquentin, chez Sartre, est dégoût devant une racine, cette vie qui tend absurdement vers le surcroît, pur déploiement de matière et volonté de puissance qui, in fine, ne peut que sombrer dans la mort.
Drusilla vieille aurait été un épouvantail, un effroi, la mesure, l’horloge anthropomorphique de la propre mort de Caligula, une ridicule et scandaleuse caricature de la jeune femme aimée. L’amour est donc autant promis à la péremption que le corps aimé est voué à la corruption : comment aimer celle qui, par sa dégénérescence, devient source d’angoisse ? Le choc traumatique de Caligula, au début de la pièce, est donc triple : mort de Drusilla, conscience de la finitude et faillite du langage chez celui qui a dit et entendu « je t’aime » et qui prend conscience de l’inanité de ces mots. Or il semble que pour Camus l’amour soit, dans la déréliction de l’immanence, et à l’exception de la révolte, le seul fondement possible du sens 15 .
Dans une de ses nouvelles, « La femme adultère », tirée du recueil L’exil et le royaume, Camus décrit deux commerçants d’Alger, Marcel et Jeannine, mariés depuis vingt ans, un bail bien trop long pour que leur amour, vivace au début, n’ait pu être usé. Dans un paysage de désert algérien bien connu de l’auteur, et qui métaphorise ici la solitude du délaissement, la condition métaphysique de l’homme contemporain, cette « croissance du désert » que Nietzsche annonce, les deux époux sillonnent les routes pour vendre leurs produits. Une nuit, Jeannine a une révélation. Après avoir quitté la chambre commune et s’être exposée au vent glacé du désert, elle regagne le lit, un événement que Camus commente en ces termes :
« Marcel avait besoin d’elle et elle avait besoin de ce besoin, elle en vivait la nuit et le jour, la nuit surtout, chaque nuit où il ne voulait pas être seul, ni vieillir, ni mourir, avec cet air buté qu’il prenait et qu’elle reconnaissait parfois sur d’autres visages d’hommes, le seul air commun de ces fous qui se camouflent sous des airs de raison, jusqu’à ce que le délire les prenne et les jette désespérément vers un corps de femme pour y enfouir, sans désir, ce que la solitude et la nuit leur montrent d’effrayant. Marcel remua un peu comme pour s’éloigner d’elle. Non, il ne l’aimait pas, il avait peur de ce qui n’était pas elle, simplement, et elle et lui depuis longtemps auraient dû se séparer et dormir seuls jusqu’à la fin. Mais qui peut dormir toujours seul? Quelques hommes le font, que la vocation ou le malheur ont retranché des autres et qui couchent alors tous les soirs dans le même lit que la mort (…). Elle l’appela de tout son cœur (…). Elle aussi avait peur de mourir (…)».
L’amour, puis son fantôme a minima, celui de l’amour par inertie, de la relation routinière est donc un remède aux monstres d’angoisse que l’absence de sommeil, la nuit, enfante. S’il ne se peut faire que nous ne mourrions jamais, dormons toujours à deux. Camus décrit ici une relation par défaut, celle du confort métaphysique, de la commodité psychologique, sans parler de la sécurité sexuelle et matérielle. L’être-à-deux se survit à lui-même, faute de mieux, faute d’autre chose, et pour obvier à la désespérance d’une solitude qui serait confrontation avec un néant que la nuit révèle, dans le silence de l’otium, dans l’absence de bruit, de fureur et de divertissement. La relation amoureuse n’apparaît pas ici comme une attitude active, comme un mouvement de don vers autrui, comme un élan volontaire et plein, mais semble procéder d’un vide à combler. Le mouvement vers autrui est essentiellement négatif. Il vise à combler une vacuité, il est moins désir que besoin. On embrasse et se terre à deux pour conjurer le désespoir d’une solitude et d’une confrontation sans médiation avec la mort.
Avec le passage du temps, l’amour devient ce choix par défaut peureusement opposé au néant. Il reste qu’être à deux constitue une manière active de faire reculer l’absurde en créant du sens. Être à deux, c’est parler, s’inventer une histoire, s’illusionner, rêver, produire du sens en produisant un récit sur soi et sur son histoire commune. Etre à deux, c’est également s’inscrire dans un pro-jet où l’être-jeté trouve une destination, cette destination qui lui est refusée par l’absence de toute providence ou de tout destin. Ce projet va de la trivialité du court terme (l’achat d’électro-ménager ou la décoration du salon) au supplément d’âme du moyen (les vacances en Toscane) et du long terme (les enfants, la grande maison de campagne de la retraite).
L’être-à-deux confère signification et direction aux travaux et aux jours, dont la monotone litanie n’est pas, pour le solitaire, distraite par le son ou exorcisée par le sens du récit commun. En l’absence de(s) dieu(x), il y a donc tout de même une présence, certes faillible et mortelle, mais garante de sens (signification et direction). Dans un monde désenchanté, privé de la présence de(s) dieu(x), puisqu’il n’est plus d’être-à-dieu, il n’est que l’amour et l’être-à-deux qui soit producteur de sens.
Caligula, dans sa quête de sens et dans son insondable désespoir, refuse cet accommodement et ne perçoit que vanité de cet être-à-deux, qui est affecté de la même finitude que les êtres qui le composent, voués à la vieillesse et à la mort :
« Si l’amour suffisait, tout serait changé. Mais où étancher cette soif ? Quel cœur, quel dieu auraient pour moi la profondeur d’un lac ? Rien dans ce monde, ni dans l’autre, qui soit à ma mesure».
(IV, 14)
L’angoisse de Caligula est démesurée. Nul amour ne peut l’apaiser. L’amour n’est pas assez : lui aussi n’est que passage, comme les êtres qui aiment et les êtres aimés, lui aussi est charrié par les tombereaux du temps vers le charnier du néant, de ce qui n’est tellement plus qu’il n’aura jamais été.
Ce qui est refusé au couple amoureux est peut-être autorisé à la communauté politique, à cette communauté humaine qui se forme entre les conjurés ligués pour abattre le tyran. Il peut paraître curieux de faire de la cité une communauté d’amour. C’est pourtant une conception classique, due à Aristote, qui fait de la philia le fondement de la cité 16 et qui défend que la « communauté est d’essence affective (philikon) 17 ». Par la philia, le solitaire devient solidaire, l’homme de la déréliction, faute de mieux et dans la conscience de la finitude et de l’imperfection de son projet, crée une communauté humaine constituée par « ce goût de l’homme sans quoi le monde ne sera jamais qu’une immense solitude 18 ». Cette communauté est créatrice de sens, car l’on y aime (solidarité, humanisme), car l’on s’y révolte (la Résistance et le Camus de Combat), parce que l’on y formule un récit d’appartenance, de provenance et de direction. La décision de construire le sens en édifiant la communauté des frères humains est la seule alternative au meurtre et au suicide qui ne marquent, au fond, qu’un surcroît de souffrance.
-
L’âge d’Albert Camus quand il rédige Le mythe de Sisyphe : « Nous vivons sur l’avenir : "demain ", "plus tard", "quand tu auras une situation ", "avec l’âge, tu comprendras". Ces inconséquences sont admirables, car enfin il s’agit de mourir. Un jour vient pourtant et l’homme constate ou dit qu’il a trente ans », Paris, Gallimard, Folio, [1942], 1995, p. 30 ↩
-
Le Dasein est le seul étant qui peut penser l’être (dont il a dès lors la garde) et la mort, sa propre mort. Le refus de la pensée marque donc la double déchéance d’un refus de la responsabilité et de la vocation du Dasein. ↩
-
BEAUVOIR, Simone de, Mémoires d’une jeune fille rangée, Paris, Gallimard, [1958], rééd. Folio, 1986, pp. 191-192. ↩
-
CAMUS, Albert, L’homme révolté, Paris, Gallimard, Folio, [1951], 2005, p. 41. ↩
-
Ibid., p. 132. ↩
-
Bien des caractères du national-socialisme font de cette idéologie l’entéléchie du nihilisme contemporain. Le nazisme a congédié les arrière-mondes, quoi que des références folkloriques à Wotan, au Walhalla ou à une Providence de l’élection puissent faire accroire. Le nazisme défend une pure immanence, celle du sang et de sa puissance. Nietzsche, relu et commenté par Heidegger, remarque que, en l’absence de(s) dieu(x) édicteur(s) de valeurs transcendantes, la valeur ne peut plus être recherchée que dans l’immanence. Pour évaluer une vie, il faut désormais interroger son intensité, ou sa puissance. La volonté de puissance étant désormais la seule essence de l’être de l’étant et, partant, la seule valeur, le monde, selon Heidegger, est livré à la puissance du Dasein, dont l’instrument est la calculation machinalisante de la raison. Le règne de la technique qui est provocation, exploitation et consomption de l’étant signe l’achèvement d’une métaphysique qui avait instauré une dualité entre sensible et intelligible, puis entre terrestre et céleste, avant de congédier l’intelligible et toute question sur l’être, afin de livrer l’étant, devenu la pure res extensa cartésienne, au calcul consumant de la raison. Le nazisme du plan quadriennal (1936), de la cavalerie blindée, du Blitzkrieg, du triomphe de la technique est un nihilisme, au même titre que le bolchevisme et le capitalisme, cet étau de l’Est et de l’Ouest dont Heidegger espérait que la révolution nazie contribuerait à le desserrer. Le nazisme est dénoncé comme tel par Heidegger, à mots couverts, mais suffisamment explicites pour qui en est familier : le séminaire « La menace qui pèse sur la science » de 1936-1937, puis les cours sur Nietzsche de 1941 en témoignent assez, dans lequel Heidegger estime que la Wehrmacht a pu vaincre la France car les Allemands, par le national-socialisme, sont devenus plus cartésiens que les français, et représentent une humanité fidèle à l’essence de cette métaphysique achevée qu’est la technique. La domination technique, expression de la volonté de puissance, parachève l’oubli de l’être et l’oubli de l’oubli. Cette domination d’un étant objectivé et consumé par l’industrie et la guerre industrielle éloigne l’Allemagne et l’Occident de l’horizon hölderlinien d’une « habitation pensante et poétique du monde ». La révolution nationale allemande a succombé à la vocation historiale de l’occident : l’achèvement de la métaphysique (la dichotomie être/étant de la différence ontologique) et la domination du calcul objectivant et destructeur. La dévastation du monde est en marche : « Le désert croît », une intuition nieztschéenne que rappelle Heidegger quand il écrit que « l’homme ne peut plus qu’errer dans les déserts de la terre ravagée ». ↩
-
C’est ainsi que Schopenhauer décrit l’éthos pessimiste : « L’instant de la mort pourrait être semblable à celui où l’on s’éveille d’un rêve pénible, où l’on sort d’un cauchemar ». Le pessimiste vit un cauchemar : rien ne pourrait être pire. ↩
-
Nizan, Paul, Les chiens de garde, Paris, Rieder, [1932], rééd. Marseille, Agone, 1998, 191 p., p. 25. ↩
-
VALERY, Paul, « La crise de l’esprit », [1919], Variété II, [1930], in Variété I et II, Paris, Gallimard, Folio Essais, 1998, 317 p., p. 17. ↩
-
CAMUS, Albert, L’homme révolté, Op. cit., p. 353. ↩
-
Ibid., p. 133. ↩
-
Ibid., p. 19. ↩
-
Ibid., p. 20. ↩
-
Ibid., p. 31. ↩
-
Le thème de l’amour est le grand inachevé de l’œuvre camusienne. Dans son discours de réception du Prix Nobel de littérature, en 1952, il explique avoir doté son projet créatif d’une architectonique au sein de laquelle le dernier terme, l’amour, est demeuré une simple pierre d’attente, mais devait faire l’objet d’un traitement ample et ambitieux : « J’avais un plan précis quand j’ai commencé mon œuvre : je voulais d’abord exprimer la négation. Sous trois formes. Romanesque : ce fut L’Étranger. Dramatique : Caligula, Le Malentendu. Idéologique : Le Mythe de Sisyphe. Je prévoyais le positif sous trois formes encore. Romanesque : La Peste. Dramatique : L’Etat de siège et Les Justes. Idéologique : L’Homme révolté. J’entrevoyais déjà une troisième couche autour du thème de l’amour. » ↩
-
Politique III, 9, 1280 b ↩
-
Politique IV, 11, 1295 b. ↩
-
CAMUS, Albert, « Défense de l’intelligence », conférence du 15 mars 1945, Marseille, in Actuelles - Ecrits politiques, Gallimard, Folio, 1997. ↩