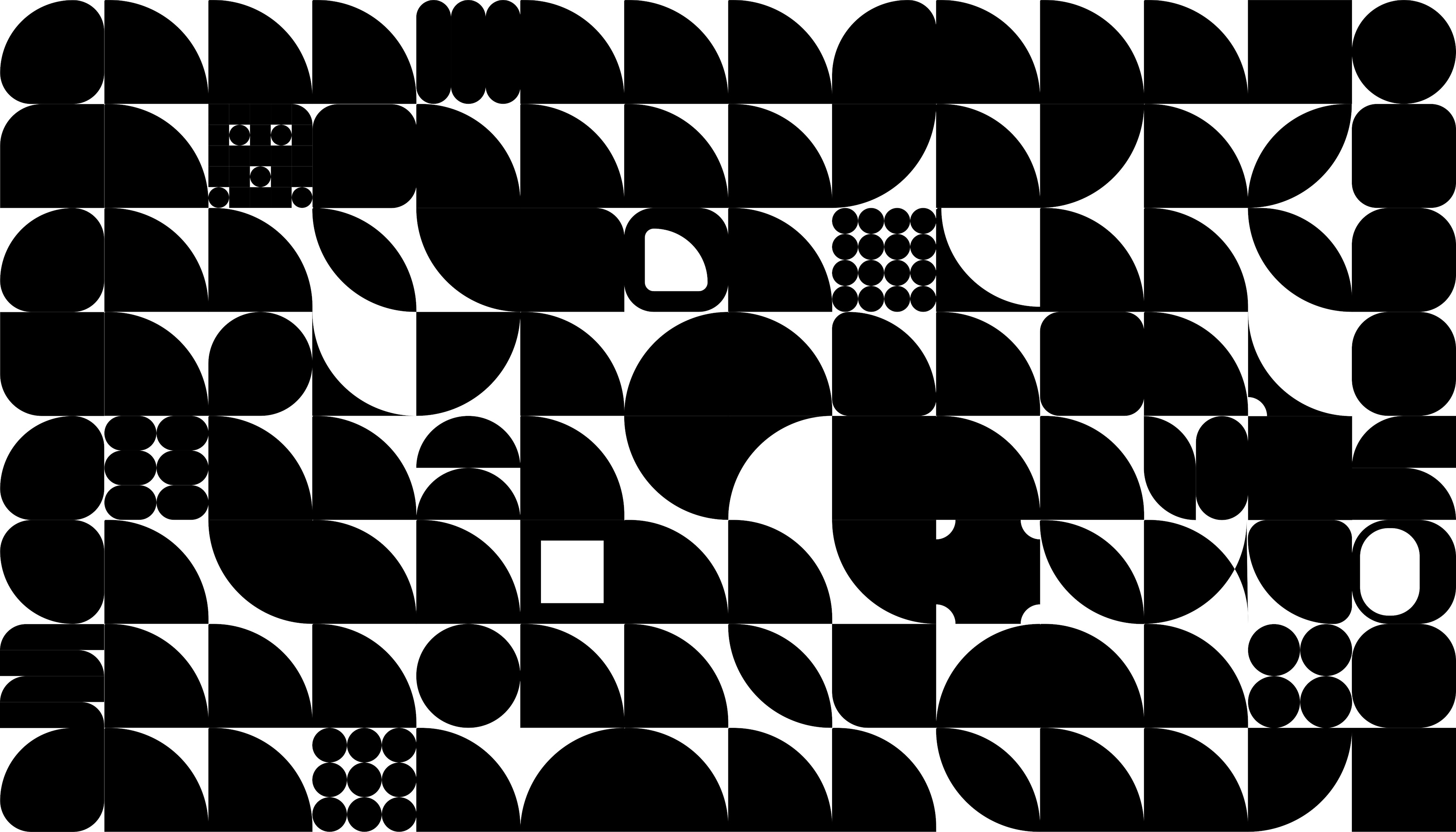Je fais l’exercice de l’écrire. Pour que les gens aient un repère différent que celui du DSM-V. Un repère tangible et vérifiable, sans case à cocher ni symptômes à inventorier. (Lapierre-Dallaire 2021)
On entend parfois des mots lourds de préjugés, au détour d’une publicité, d’un film ou d’un article de journal. On parle de « folie, de dérangés, de fuckés et d’anormaux ». On utilise des termes péjoratifs, ou alors on ne dit rien du tout. On évite le sujet, on n’en parle qu’à demi-mot, on chuchote que l’un est bipolaire, et que l’autre est devenu tellement anxieux qu’il a dû aller à l’hôpital. On relègue les troubles de santé mentale à des tiroirs qu’on ne tire que peu souvent.
La situation certes s’améliore dans les dernières années, car nous semblons socialement davantage en mesure de parler de troubles de santé mentale publiquement. Malgré ces progrès qui doivent être encouragés, les troubles de santé mentale sont encore sévèrement stigmatisés (Abbey et al. 2011). Qu’est-ce que la stigmatisation ? L’association des psychiatres du Canada souligne dans leur énoncé de principe sur le sujet qu’il s’agit d’un processus multidimensionnel qui « marque une personne comme différente et la dévalorise » (Abbey et al. 2011). La stigmatisation désignerait ainsi « un attribut, un trait, ou un trouble qui marque un individu comme étant inacceptablement différent des personnes “normales” avec lesquelles il interagit habituellement et entraîne une sanction quelconque de la collectivité » (Abbey et al. 2011). Généralement, on différencie entre le stigma perçu et la stigmatisation internalisée. Dans le premier cas de figure, la personne souffrant d’un trouble de santé mentale perçoit des préjugés et de la discrimination des autres. Dans le deuxième cas, la personne applique ces préjugés à sa propre personne, se dévalorisant donc elle-même (Pattyn et al. 2014).
Cet imaginaire collectif entourant les troubles de santé mentale se véhicule et se construit entre autres par le champ lexical qui y est relié, comme le démontrent de multiples recherches qui exposent l’impact négatif que les mots et les expressions à connotation péjoratives peuvent avoir sur les personnes concernées (Richmond 2014). Les mots qui sont utilisés quand nous abordons le sujet de la santé mentale teintent notre vision de ces troubles, changeant alors nos comportements et notre attitude face aux personnes qui en sont atteintes. L’association des psychiatres du Canada soulève les conséquences graves de la stigmatisation envers les personnes qui souffrent de ces troubles, telles que des difficultés à suivre un traitement et à accéder aux soins, des difficultés sociales et économiques et des barrières au rétablissement (Abbey et al. 2011). On parle ici d’un problème lourd de conséquences, auquel il est donc vital qu’on s’attarde.
Ce projet se veut une étude littéraire qualitative, qui s’intéresse à la stigmatisation des personnes vivant avec des troubles de santé mentale par l’entremise des termes descriptifs. Cette recherche permet de mieux comprendre comment l’expérience de la psychiatrie et des troubles de santé mentale est vécue par les personnes concernées, au travers d’œuvres littéraires autofictionnelles abordant directement ou indirectement la stigmatisation envers les personnes vivant avec des troubles de santé mentale. La question de recherche se pose ainsi : quels chemins sémantiques prend la stigmatisation dans la littérature ? Afin d’explorer cette question, nous avons commencé par sélectionner une liste d’œuvres littéraires. À la lecture de ces œuvres, des extraits mettant en scène la perception des troubles de santé mentale ont été retenus. D’une part, nous avons émis des commentaires généraux sur ces extraits, afin de tisser des liens avec ce qui a déjà été observé dans la littérature médicale. D’autre part, une deuxième partie sera réservée à l’écriture libre de l’autrice, écriture qui est inspirée de ces extraits. L’idée est de se mettre en jeu et d’exprimer par l’entremise de mots libres une critique du système, des biais internalisés des soignant·e·s et de sa propre histoire qui nous conduit à y participer. La littérature permet une expression de soi différente, et c’est dans cette visée que nous voulons explorer à la fois ce que les personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale ont à dire et comment l’autrice y réagit.
Survol de la littérature
Avant de préciser la méthode, il est pertinent de s’arrêter aux connaissances sur le sujet. La première partie de cette étude consistait en un survol de la littérature scientifique. D’une part, cette revue de littérature visait à comprendre ce qui est déjà connu sur les mots utilisés qui pourraient participer de la stigmatisation envers les personnes souffrant de troubles de santé mentale. D’autre part, elle visait à comprendre comment cette stigmatisation est vécue par les personnes concernées. Pour ce faire, 3 différents alliages de termes ont été utilisés pour lancer une recherche dans la base de données PubMed, Embase, PsychINFO et CINAHL. Nous nous sommes limités aux 10 dernières années, dans l’objectif d’avoir une perspective contemporaine sur le sujet. Cette recherche a permis de trouver 165 articles, qui ont ensuite été raffinés selon certains critères afin d’en faire ressortir les plus pertinents, n’en gardant que 65. De ces 65 articles, il est possible de dresser certains constats.
Tout d’abord, lorsqu’on s’intéresse aux mots contributifs à la stigmatisation envers les personnes souffrant de trouble de santé mentale, nous pouvons constater que les études portent majoritairement sur les médias, et peu sur la littérature. Les études des dernières années s’intéressent particulièrement aux médias sociaux, aux journaux et à la télévision. La majorité de ces études n’abordent pas nécessairement les termes spécifiques qui pourraient être stigmatisants, mais davantage la représentation écrite générale que ces médias font de ces personnes. La majorité des études s’entendent pour dire que les articles abordant les troubles de santé mentale sont majoritairement à connotation négative, et ce partout à travers le monde d’où proviennent ces études (Aci et al. 2020; Aragonès et al. 2014; Flynn, Gask, et Shaw 2015; Kunitoh et Suzuki 2015; Nawková et al. 2012). On retrouve la même conclusion dans les études portant sur les médias sociaux tels que Twitter (Athanasopoulou et Sakellari 2016). On découvre alors que les termes péjoratifs utilisés sont surtout reliés à la notion de dangerosité et de violence (McGinty et al. 2016; Murphy, Fatoye, et Wibberley 2013). Une des rares études abordant spécifiquement les mots employés se penche sur l’utilisation du mot « psychose » ou « schizophrène » lorsqu’ils sont utilisés métaphoriquement dans les médias, et conclut que l’utilisation métaphorique de ces termes est majoritairement à connotation négative (Bevilacqua Guarniero, Bellinghini, et Gattaz 2017). La schizophrénie semble être un des diagnostics les plus stigmatisés, et celui bénéficiant le moins de la réduction de la stigmatisation envers les troubles de santé mentale observée dans les dernières années (Anderson et al. 2018; Gwarjanski et Parrott 2018). On souligne qu’il n’y a généralement que peu de voix dans les médias des personnes qui souffrent de troubles de santé mentale pour faire contrepoids aux idées avancées (Bevilacqua Guarniero, Bellinghini, et Gattaz 2017). De plus, il y a souvent des étiquettes diagnostiques émises qui sont supposées plutôt que fondées médicalement, contribuant ainsi à une mauvaise compréhension de la maladie (Bevilacqua Guarniero, Bellinghini, et Gattaz 2017).
Il est répertorié dans de multiples études que la stigmatisation serait généralement en diminution dans les 10 dernières années, même si elle reste prévalente (Anderson et al. 2018; Stupinski et al. 2022; Thornicroft et al. 2013; Whitley et Berry 2013; Whitley et Wang 2017; Ye et al. 2016). On apprend aussi en s’intéressant à la perception des patient·e·s sur la stigmatisation que ces personnes souffrant de troubles de santé mentale perçoivent généralement être sévèrement stigmatisées (Bipeta, Yerramilli, et Pillutla 2020; Daumerie et al. 2012; Rezayat et al. 2019), sans égard au type de trouble de santé mentale spécifique (Farrelly et al. 2014). Cette perception mènerait à plusieurs conséquences socio-économiques et psychologiques majeures (Hansson, Stjernswärd, et Svensson 2014; Koschorke et al. 2014). De plus, l’autostigmatisation semble entraîner des conséquences aussi délétères que la stigmatisation perçue (Lv, Wolf, et Wang 2013). Le constat est sans équivoque ; il y a un lien clair entre l’intensité de la stigmatisation dans les médias et l’impact général sur les personnes souffrant de troubles de santé mentale (Bowman et West 2019; Goepfert et al. 2019). Plusieurs études s’intéressent à savoir si cette intensité varie selon des sous-groupes catégoriels de personnes (par exemple les femmes, les personnes racisées, la communauté LGBTQIA+, etc.), mais il ne semble pas y avoir de consensus clair sur cette question.
Plusieurs études existent sur la stigmatisation perçue par les patient·e·s par l’entremise de la représentation écrite, mais peu explorent spécifiquement ce qui dans le langage commun pourrait le plus contribuer à cette stigmatisation. Nous n’avons pas trouvé d’étude portant spécifiquement sur la perspective des patient·e·s sur la stigmatisation à travers la littérature (par exemple, qu’est-ce qui pourrait déranger ces patient·e·s en lisant des romans ? Les romans populaires sont-ils perçus comme étant stigmatisants ?). Nous n’avons pas non plus trouvé d’étude provenant de sources de recherches médicales portant uniquement sur la stigmatisation envers les troubles de santé mentale dans la littérature (sans la perspective des patient·e·s), outre une seule étude analysant l’utilisation du terme folie dans l’œuvre de Jack Kirouac (Wigand, Rüsch, et Becker 2016). Le domaine des études littéraires comporte probablement plus d’études portant sur la stigmatisation dans les œuvres écrites, comme par exemple l’utilisation et l’analyse d’œuvres littéraires spécifiques pour ouvrir des discussions sur la stigmatisation (Richmond 2014). Somme toute, notre survol démontre tout de même que notre sujet d’intérêt spécifique est généralement peu exploré dans la littérature médicale traditionnelle.
La recherche-création
Ce projet s’inscrit dans l’approche de la recherche-création. Le conseil de recherche en sciences humaines du Canada définit cette approche comme une combinaison des « pratiques de création et de recherche universitaires et favorisant la production de connaissances et l’innovation à l’expression artistique, à l’analyse scientifique et à l’expérimentation » (« Mission et gouvernance », s. d.). Le processus de création fait partie intégrante de la recherche et s’y lie étroitement. La recherche-création soutient le développement de projets expérimentaux et critiques, et qui intègrent l’art dans les processus de pensée (s. d.). Nous prenons entre autres en exemple Hexagram, un large réseau interdisciplinaire de plus d’une cinquantaine de chercheur·e·s et de plus de deux cents étudiant·e·s qui se consacrent à la recherche-création en arts, culture et technologies au Québec (s. d.). Dans le réseau de la santé, soulignons l’apport d’Organon, un espace de recherche-création sur les récits du don et de la vie en contexte de soins lié à la chaire McConnell de l’Université de Montréal. Ce regroupement en recherche-création s’attarde aux « récits du don et de la vie en contexte de soins et vise à développer une relation de confiance durable entre patient·e·s et profesionnel·le·s de la santé en les invitant à produire des récits qui témoignent de leurs expériences de la greffe, du don d’organes, de la maladie et du soin » (« L’Organon – Espace de recherche et de création sur le soin » 2021). L’espace y « envisage la littérature comme un espace d’hospitalité, d’accueil et d’accompagnement » (2021). Le présent projet se situe dans ce mouvement. Il s’inspire de cet alliage entre littérature et soin, et veut intégrer la création comme composante pertinente à l’évolution des mentalités en recherche en psychiatrie.
Entre psychiatrie et littérature
Pourquoi s’intéresser au stigma au travers de la littérature ? La littérature occupe une place particulière dans le discours social, renvoyant à la fois au monde artistique et à la représentation de réalités concrètes et bien vivantes. De tout temps, les théories ont été bilatérales ; la littérature influence la société, et les réalités sociales influencent la littérature (Albrecht 1954). Les troubles de santé mentale n’étaient certainement pas représentés dans la littérature au 18e siècle comme ils le sont aujourd’hui. Les thèmes sont différents, tout comme les termes et les perspectives.
La brève revue de littérature discutée plus haut a démontré que la stigmatisation est analysée dans les études médicales, surtout du point de vue des médias. Pourquoi alors s’intéresser ici à la littérature, puisque les médias semblent un véhicule potentiellement porteur de stigmas ? Premièrement, la littérature pourrait nous offrir un point de vue différent sur la stigmatisation, considérant son utilisation différente des médias. Les médias, tout comme la littérature, comportent leur biais et leurs angles morts. En explorant un autre domaine, on étend nos horizons et nos possibilités de compréhension. Deuxièmement, nous voyons dans l’expression littéraire autofictionnelle par les personnes concernées un potentiel d’empowerment. Le point de vue n’est pas à la troisième personne, celui du monde médical ; il est à la première, et s’exprime sous la forme désirée par la personne concernée. Le récit peut approfondir notre compréhension du vécu des personnes vivant avec des troubles de santé mentale, en s’éloignant des approches informatives traditionnelles sur ces mêmes troubles (Bladon 2018).
Nous soutenons donc que le discours social est influencé par la littérature et vice versa. Ainsi, les œuvres littéraires sont un bastion qu’il est intéressant d’explorer. Comment sont dépeints les troubles de santé mentale dans la littérature ? Plus particulièrement, comment les gens aux prises avec ces troubles écrivent-ils sur les troubles de santé mentale ? Que trouvent-ils stigmatisant, difficile à entendre, stéréotypé ?
Méthode
Notre première étape fut d’établir une liste d’œuvres littéraires connues abordant les troubles de santé mentale ou indirectement la stigmatisation qui y est reliée. Le répertoire choisi était constitué de 17 œuvres (une œuvre étant ici définie comme un écrit publié, sans distinction pour le type de maison d’édition). Nous avons mis l’accent sur des œuvres québécoises (hormis quelques exceptions qui devaient être traduites en français), afin de refléter l’expérience des personnes qui naviguent dans le système de soins que nous connaissons. Nous avons choisi des romans ou de la poésie, car ce sont typiquement ces types d’écrit qui explorent davantage le vécu affectif. Les œuvres sont issues de la période contemporaine, afin de refléter les enjeux actuels reliés à la stigmatisation. Elles sont aussi autofictionnelles, encore une fois dans l’optique de s’attarder aux vécus expérientiels des personnes concernées. Finalement, il n’y avait pas de restriction sur le type de trouble de santé mentale, car nous nous intéressons d’abord au vécu des personnes, qui pour certaines personnes peut passer par un questionnement ou une réfutation diagnostique. Nous avons aussi porté attention à ce que ces œuvres soient représentatives de la diversité des personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale.
Nous avons lu ces œuvres avec l’objectif de trouver des extraits comportant des expressions, des champs lexicaux ou des passages qui décrivent la stigmatisation ou l’autostigmatisation envers les personnes souffrant de troubles de santé mentale. Nous avons récolté 122 extraits au total. Nous avons ensuite effectué un raffinement des extraits afin de sélectionner ceux qui étaient le plus sujets à analyse. Nous avons choisi des extraits qui contenaient des termes clairs qui pouvaient être reliés à la stigmatisation, qui devaient amener une réflexion sur le vécu de la personne, et finalement qui devaient être écrits dans un style et un langage clair et accessible au public. Nous avons sélectionné 42 extraits finaux. Par la suite, nous avons regroupé ces divers extraits en thèmes et nous avons tenté de voir quelles étaient les grandes similitudes entre les extraits et quels étaient les liens à faire avec la revue de littérature effectuée. Ces similitudes ont ensuite été la source d’inspiration du processus créatif de l’auteure dans la deuxième section, dans laquelle l’auteure se met personnellement en jeu en tant que soignante qui participe à un système qui perpétue certaines attitudes face aux personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale. La posture de scientifique peut créer une certaine distance avec les patient·e·s et leur vécu en évacuant ce qui est perçu comme subjectif ; faire l’exercice de conscientiser ses propres réactions et biais pourrait-il participer d’une critique qui n’est pas seulement envers un système global, mais qui inclut l’humanité de ceux et celles qui y participent ?
Comme discuté plus haut, la stigmatisation est un sujet généralement peu abordé, tout comme les mots utilisés pour stigmatiser autrui. L’objectif est ici de sensibiliser les soignant·e·s, afin de contribuer à une culture psychiatrique inclusive et non discriminante. L’impact d’un tel travail est aussi de tisser des liens entre le monde médical et littéraire, en décloisonnant les murs qui peuvent éloigner l’aspect créatif du soin. Notre recherche a plusieurs limites. Bien que la sélection des œuvres soit basée sur certains critères, une certaine subjectivité subsiste ; un biais de sélection est lié aux connaissances littéraires des auteures de cette recherche, et des données disponibles pour répertorier les livres. Dans le même ordre d’idées, l’analyse des extraits et leur sélection pour exemplifier notre propos comportent aussi un biais de sélection. Ainsi, nous sommes conscientes que l’objectif n’est pas d’établir avec objectivité des paramètres sur les mots à utiliser et les actions à prendre, mais bien de susciter des questions, d’ouvrir le débat et d’offrir des pistes de réflexion.
Résultats
Nous avons classé les extraits en catégories selon les ressemblances notées, afin d’en tirer certains constats. Rapidement, nous avons pu voir que certains termes revenaient dans plusieurs des extraits choisis et nous les avons divisés en trois catégories de termes. La première grande catégorie de termes ayant un lien avec la stigmatisation est le mot « folie » et ses dérivés. Plus de 28 extraits sur les 42 utilisaient ce terme, majoritairement avec une connotation négative, et à quelques reprises dans une optique de réappropriation. Mary Barnes, dans son récit autobiographique sur la schizophrénie vécue dans une maison alternative de soins, écrit : « il n’y avait pas moyen d’aborder ce sujet avec mes parents. Un jour j’essayai “pourquoi vous faites-vous tant de mal ?”. Ils pensèrent que j’étais complètement folle et je le sentis » (Barnes et Berke 1973). Elle rajoute plus tard à propos de son frère vivant aussi avec la schizophrénie : « La vie affective de la famille le tuait, lui brisait le cœur. Peter, que la colère rendait muet, s’isola de plus en plus. Le reste de la famille était considéré comme sain. Lui était fou » (Barnes et Berke 1973). Michelle Lapierre-Dallaire aborde une autre vision décapante du mot folie : « J’ai compris que, dès que j’élève la voix, dès que je nomme adéquatement les actions des hommes que je me donne un peu trop de liberté, ça ne fait pas leur affaire. Pour le redire dans leurs mots : une agace, une petite menteuse, une crisse de folle, une fucking cunt, une ostie de pute. Ma mère a compris ça bien avant moi » (Lapierre-Dallaire 2021).
Le deuxième type de terme le plus utilisé fait appel au champ lexical de la maladie (9 extraits sur 42). Dans ce registre, on retrouve des mots comme « malade mental », une femme « triste, malade, moindre » (Raymond 2017), un « cas à disséquer » (Labrèche 2003). Marie-Sissi Labrèche écrit, plus loin : « Ça fait partie de ma personnalité, d’être nerveuse et excitée. De ma personnalité malade ; malade, car j’ai commencé une thérapie, et le thérapeute tout affalé dans son fauteuil m’a dit que j’ai une personnalité malade. Une personnalité qui a la grippe. Non, pire, j’ai un cancer de la personnalité : une boule accrochée en moi et qui se nourrit de mes cellules depuis que je suis toute petite » (Labrèche 2003). Le troisième type de terme rencontré est lié au fait d’être diagnostiqué ou d’avoir une étiquette, étiquette qui est alors mal perçue ou mal utilisée (3 extraits). Le poète Jean-Philippe Bergeron exprime avec justesse :
tu signeras un refus de traitement
ce n’est rien que l’anthropophagie
des signes entre eux
dans le cerveau d’un schizophrène de foire
te dis-tu (Bergeron 2016)
On peut alors se demander ; quel est le rôle joué par ces étiquettes dans la perception du corps soignant à l’égard des personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale ? Comment voit-il les gens qui ont maintenant ces termes accolés à leur parcours de soins ? Finalement, deux extraits sur les 42 font ressortir d’autres termes que nous n’avons pas pu placer dans les trois catégories décrites ci-haut, tels que « cinglé », « fucké dans le coco » (Cloutier-Charette 2020).
En catégorisant les extraits ainsi, cela nous permet de voir quels termes ou quels champs lexicaux sont les plus prévalents, et de se questionner sur les effets de ces termes. Par exemple, nous constatons que le mot folie est très utilisé, et ce de plusieurs manières. Il est majoritairement utilisé par les auteur.e.s pour décrire comment les autres les traitent, mais aussi comment ils se perçoivent eux-mêmes, ce qui rejoint davantage l’autostigmatisation. On trouve cependant quelques exceptions, dans lesquelles les auteur·e·s sont « fous » et voient cela positivement, ou se réclament d’une certaine folie créative. Ainsi, l’expérience des personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale est déterminante dans la compréhension de l’aspect éthique et moral de l’utilisation de termes qui peuvent être stigmatisants.
En analysant les extraits recueillis, on voit aussi que les passages qui parlent autant d’autostigmatisation que de stigmatisation externalisée sont souvent en lien avec les diagnostics reçus. En adoptant cette perspective, nous avons pu diviser en trois grands thèmes les extraits, indépendamment de la première classification discutée plus haut. Ces trois thèmes contiennent tous à peu près un nombre égal d’extraits ; des extraits parlant de psychose et de schizophrénie (13 extraits), de trouble de personnalité limite (15 extraits) et de troubles de l’humeur tels que la dépression ou la bipolarité (14 extraits). De ce constat, on peut tirer quelques observations intéressantes. Premièrement, les extraits sur la psychose et la schizophrénie comportent presque tous le mot « folie », la première catégorie de la classification précédente. Cela suscite la réflexion. Comment considère-t-on socialement la schizophrénie, comparativement à d’autres troubles de santé mentale ? Nous pouvons lier cette constatation avec ce que nous a montré notre revue de la littérature, soit que les troubles psychotiques semblaient être les plus stigmatisés dans les médias. Un autre grand thème semble être la perception sociale des gens vivant avec un trouble de personnalité limite, comme l’exprime Katherine Raymond dans son livre: « Je suis donc passée du sceau de l’épisode dépressif sévère et du deuil compliqué à celui du trouble de personnalité limite. Un nouveau mot devant mes réactions inappropriées à la tragédie. Un nouveau mot en forme d’explication, pour que tout le monde pousse un grand soupir de soulagement. Un mot pour dire que je n’étais pas des leurs, que je ne l’avais jamais été » (Raymond 2017). À quel mécanisme d’exclusion sociale les mots participent-ils ? Les auteur·e·s qui abordent les troubles de l’humeur décrivent aussi cette dynamique d’exclusion, par l’entremise de termes qu’ils appliquent envers eux-mêmes ou qui sont entendus. Dans les deux cas, ces termes créent une scission entre la personne qui a un trouble de santé mentale et les autres. Varda Étienne, une femme d’affaires, animatrice et auteure québécoise, écrit dans son livre sur la bipolarité : « Papa entre dans la chambre pour m’engueuler encore. Il me trouve dans cet état et décide de me faire emmener d’urgence en ambulance à l’hôpital. Quand les ambulanciers arrivent, ils trouvent maman toujours en pleurs. Papa leur dit :
― Je ne sais plus quoi faire… je crois que c’est un cas d’urgence psychiatrique.
Le mot est lâché. Pour la première fois, on me traite comme une vraie folle » (Étienne 2009).
Les auteur·e·s utilisent des mots qui viennent teinter leur expérience personnelle d’une manière particulière et personnelle. Les extraits nous ont permis de comprendre que le mot « folie » est certainement l’un des termes les plus poignants et les plus à l’avant-plan dans le discours autostigmatisant ou stigmatisant. Il est pour la plupart du temps utilisé de manière péjorative. La psychose, les troubles de personnalité et les troubles de l’humeur semblent être tout aussi explorés, mais font valoir des expériences assez différentes. Une fois que cette analyse plus catégorielle des extraits est amorcée, on peut maintenant se poser la question ; que doit-on comprendre de cette utilisation des mots « folie », « cinglé », « malade mental » ?
Dans la prochaine portion, l’objectif est de s’inspirer des lectures choisies et de leur analyse à travers le mode singulier de la création. En pensant à partir des ressentis amenés par ces extraits, l’autrice se met en jeu et se critique à la fois elle-même et le système auquel elle participe, en réfléchissant à comment la stigmatisation est véhiculée dans et par le milieu de soin, dans les mentalités et la réalité de l’acte soignant.
Écriture
la porte est par ici
l’urgence. la sonnette du grand bâtiment, le détecteur de métal, l’enregistrement. les patients passent, mouches dans le filet institutionnel.
oui bonjour vous venez de vous suicider venez-donc par ici quel est le nom de vos parents quelle est votre adresse de quelle manière êtes-vous mort donnez-moi votre carte RAMQ donnez-moi vos pleurs montrez-moi toute cette émotion intime qui vous a habité pendant que vous êtes monté sur le tabouret dans votre garage
salut moi c’est l’infirmière avez-vous des antécédents judiciaires avez-vous un médecin de famille ici c’est la salle d’attente oui je sais les gens crient comme si les murs n’étaient pas là mais ici la normalité n’a plus de décibels il n’y a pas vraiment de murs et le réel est à l’envers oui j’ai compris vous avez voulu vous pendre le psychiatre va vous voir ce n’est pas parce que vous avez monté sur la chaise que vous avez accroché la corde mais que vous êtes redescendu parce que vous avez pensé à votre mari que vous allez passer plus vite regardez tous ces gens dans la salle d’attente il n’y a pas que vous qui soit écorché
oui salut moi c’est la travailleuse sociale vous avez entendu quoi dans la salle d’attente vous avez entendu folle vous avez entendu maudite borderline vous avez entendu renvoie la dehors la possédée l’hystérique oui madame je suis désolée c’est bien triste tout cela bien triste mais revenons au plan : qu’est-ce qui vous éloigne de la mort ?
vous êtes-vous demandé ce qu’il signifie ce bureau entre vous et moi
bonjour moi c’est la résidente avez-vous des mots pour parler plus vite parce que je n’ai que peu de temps dites-moi qu’est-ce qui vous empêche de vous pendre de nouveau y a-t-il un fond de feu qui brûle dans votre cage thoracique déchirée une forme d’envie de vivre abstraite ou est-ce que c’est totalement noir cendré donnez-moi la liste de vos médicaments comment ça vous n’avez aucune idée des doses
comment tresser ce fil entre vos pleurs et mon chronomètre
fil de poèmes-réponses
« Je suis un cas à étudier, à disséquer comme une souris de laboratoire. D’ailleurs, le psy du CLSC l’a compris et veut que j’aille me faire traiter. Me faire traiter ! Traiter de quoi au juste ? De folle, comme ma mère folle ? De pas normale, comme ma mère pas normale ? » (Labrèche 2003)
j’ai juste pris deux speeds
j’ai voulu dire
enwèye avance
je me suis échappé j’ai dit
si t’avance pas
je te défonce le crâne
à coup de marteau
si ton vocabulaire
dépasse ma ligne
les colériques en isolement
les marginaux en cure fermée
les excentriques en contentions
les clés
brûlent mes doigts
« J’essayais de me protéger un peu de cette folie qui m’entourait, qui m’enveloppait, qui me pénétrait. Ça puait. Ça sentait la maladie, l’incompréhension et la marde. J’étais parkée juste à côté des toilettes.
J’entendais les autres fous crier, pleurer, sacrer. Je sais que j’ai réagi comme ça moi aussi quand ils m’ont amenée ici. J’ai craché, grafigné, hurlé. J’en suis encore épuisée » (Cloutier-Charette 2020)
j’entends folle, frustrée
j’en ai géré des dysfonctionnelles
des pleureuses
des hystériques
ce sont des enfants
elles font le bacon
tupperware à leurs excès
mets le couvercle Noémie
non madame vous ne pouvez pas partir
j’ai dit non, vous restez
non madame vous ne pouvez pas rester
j’ai dit non, vous quittez
ma décision un couteau
je le plante dans sa crise
le tourne trois fois
je suis déshumanisée
elles sont déshumanisées
femmes hystériques
Conclusion
Le langage module notre vision des troubles de santé mentale, en participant à l’imaginaire collectif et à la représentation que l’on se fait des gens vivant avec ces troubles. La stigmatisation, comme nous avons pu le voir, a des conséquences délétères multiples.
Notre étude littéraire s’est intéressée à la problématique de la stigmatisation par l’entremise des termes descriptifs utilisés dans la littérature. Notre raisonnement souligne que l’écrit participe à modeler la culture, qui elle a une influence non négligeable sur nos attitudes face aux personnes qui peuvent être mises à l’écart. Nous nous sommes donc demandé ; quels chemins sémantiques prend la stigmatisation dans la littérature ? Notre revue de la littérature a démontré que les études scientifiques investissent peu le domaine de la littérature dans ce qui a trait à la stigmatisation, mais davantage les médias et les journaux. Notre recherche, basée sur la lecture d’œuvres autofictionnelles, montre la pluralité des expériences vécues. Le terme « folie » ressort particulièrement. La vision semble majoritairement négative, bien que certains auteur·e·s se réapproprient l’expression.
Cette exploration littéraire soulève des questions plus larges, qui resteront ici non répondues. Quel est l’impact des termes diagnostiques sur le vécu des personnes qui les reçoivent ? L’objectif idéal de réduire la stigmatisation se confronte aussi à l’épreuve de la réalité dans le quotidien des soignant·e·s, et à leur rôle parfois en porte-à-faux entre bienfaisance médicale et empowerment. En tant que soignant·e·s, y a-t-il des mots que nous devrions proscrire de notre vocabulaire, ou au contraire, aider les personnes concernées à se les réapproprier, si c’est ce qu’elles veulent ? Comment naviguer cet équilibre précaire entre l’idéal langagier et la réalité quotidienne des soins ? Quel est l’avenir des mots comme « folie » ? Nous croyons que les patient·e·s sont les mieux placé·e·s pour répondre à ces questions et pour réfléchir à l’utilisation de certains mots. Pour faire suite à ce projet, il serait intéressant de développer des ateliers de création avec des patient·e·s, en leur permettant d’explorer de manière créative leur vécu en lien avec la stigmatisation.
Nous croyons que le chemin vers la réduction de la stigmatisation envers les gens souffrant de troubles de santé mentale passe par une compréhension du vécu personnel de la maladie. Il nous semble impératif d’inclure davantage la littérature dans le domaine de la recherche en psychiatrie et d’y intégrer la création centrée sur le vécu expérientiel comme un savoir en soi. Le décloisonnement ne peut que permettre l’ouverture.